
Saint Bernardin de Sienne, Daniel Arasse, préface de Roland Recht, Hazan, 240 p., 22 euro.
Bernardin de Sienne a été en son temps (le XVe siècle), un prédicateur célèbre. Celui-ci a eu un étrange destin : attaqué par les dominicains, plusieurs fois menacé de procès et même d'excommunication par Martin V, il a réussi a vaincre ses adversaires et est canonisé quelques mois après sa mort survenue en 1440 par le pape Nicolas V. La raison de ces disputes vénéneuses ? Peut-être déjà son nouvel ordre de l'observance, sa réforme profonde, même radicale, de la société, et en particulier ses considérations sur l'économie (il condamne l'usure et est uns promoteurs du principe du mont de piété), mais surtout le curieux instrument qui accompagne bientôt ses prédications : une tablette avec l'inscription Y.H.S., faisant du nom du Christ la référence absolue à la place des représentations picturales ou sculpturales. C'est cette tablette qui a tant intrigué le regretté Daniel Arasse. Il étudie dans ce beau livre avec la plus grande minutie le parcours de ce moine franciscain, qui s'était mis en tête d'évangéliser l'Italie. Cette tablette, selon lui, avec les nombreuses polémiques qu'elle a suscitées, a joué un rôle paradoxale car elle a été en fin de compte un argument pour les tenants de l'art ecclésiastique : la peinture de la Renaissance lui doit beaucoup ! C'est l'histoire de cette tablette auquel le grand historien d'art s'est attaché. Celle-ci apparaît dans quelques peintures, car c'était devenu un attribut de l'orateur et on a pu le voir représenté par le Pérugin et Pinturicchio. Mais son image disparaît complètement des églises et des monastères cinquante ans plus tard (il réapparait étrangement sous le pinceau du Greco et sous celui de Goya !) Cette aventure est absolument extraordinaire, non seulement d'un point de vue théologique, mais aussi et surtout pour les discussions qui sous-tendent la Renaissance. L'auteur du Tractatus de contractibus et usuris, ses réformes, sévères, tout cela le conduisant à la persécutions des Juifs et à l'érection de « bûchers de vanité », en somme à une attitude très réactionnaire et dogmatique, doit être regardée comme l'un des fondateurs (à son corps défendant !) de cette merveilleuse transmutation de la culture pendant le Quattrocento !

L'Inhumain, causeries sur le temps, Jean-François Lyotard, Klincksieck, 208 p., 23 euro.
De tous les «maîtres à penser » qui ont émergé pendant la période de 1968, Jean-François Lyotard a été le premier à disparaître rapidement de la scène. Sans doute sa mort précoce a été pour quelque chose. Mais c'est sa tentative de concilier Marx et Freud qui est passée de mode. Sa conception du postmodernisme n'a pas eu non plus vraiment d'échos. Ces conférences réunies dans ce volume peuvent et doivent rallumer l'intérêt pour le philosophe. Je ne m'attacherai qu'aux questions d'esthétique. Comme tout théoricien moderne de cette question, il ne peut faire autrement que d'en passer par le sublime de Kant, pierre d'achoppement obligatoire. Pourquoi diable ? D'autant plus qu'il ne parle pas d'art, mais plutôt du spectacle qu'offre la nature. Alors il ose le lien avec Freud sous la forme du « refoulement secondaire » (cela ne s'invente pas !) Sa conception du passage de la représentation dans l'art romantique à ce qui suit (par exemple, Cézanne), c'est-à-dire ce qu'il appelle l' «indéterminé » n'est pas non plus convaincant. (Il n' qu'une seule intuition quand il parle de Vernet du Salon de peinture en affirmant que l'art exigerait « le désarmement de l'esprit »). Non, si l'on veut apprécier la pensée de Lyotard, il vaut mieux quitter ce terrain et écouter ce qu'il a à dire sur le temps. Là, il se montre brillant, même s'il a tendance à une certaine versatilité dans ses raisonnements. Une étude comme « Matière et temps », pas révolutionnaire, mais mettant bien les choses en place, est non seulement lisible de nos jours, mais d'une intérêt évident. Il se révèle ici meilleur philosophe qu'esthéticien...

Première neige sur le mont Fuji, Yasunari Kawabata, traduit du japonais par Cécile Sakai, Albin Michel, 176 p., 16 euro.
Ce volume recueille des nouvelles qui ont paru dans des revues pendant les années cinquante et le début des années soixante et qui sont inédites en français. La première, qui a donné son titre à l'ouvrage, est un petit bijou, dans cette façon de dépeindre des situations de manière elliptique, avec de brefs dialogues, mais une grâce qui rend si riche ces mots posés de manière délicate et parcimonieuse : la relation amoureuse qui a été brisée entre deux jeunes gens (elle a eu un fils de lui pendant la guerre et puis s'est marié, ayant cette fois deux autres enfants avant de se séparer de son mari). Ils voyagent ensemble et tout en contemplant la neige au sommet du mont Fuji (un grand classique de l'art japonais de l'ère d'Edo), ils sont embarrassés, ne sachant pas comment renouer leur liaison amoureuse. C'est fait avec pudeur et pourtant sans rien cacher de la vérité des choses, qui est brutale. Les autres textes sont conçus dans une perspective similaire, avec des histoires de fantômes. Beaucoup d'entre elles tournent donc autour du thème de la mort ou sont sous-tendues par une fine sensation, presque imperceptible, mais inoubliable, comme un parfum dans « La Jeune fille et son odeur ». Kawabata était passé maître dans cet art de la concision, de l'allusion, et ce presque rien qui dit tant et tant. Le lire procure une joie profonde, même si ses écrits laissent transparaître une tristesse intense et une mélancolie infinie.

A la lecture, Véronique Aubouy/Mathieu Riboulet, Grasset, 240 p., 18 euro.
Dans leur postface, les auteurs parlent de « livre gigogne ». C'est vrai. Mais c'est aussi un livre digressif. On saute d'un sujet à l'autre sans un ordre strictement établi. D'ordinaire, je n'aime pas la littérature digressive. Mais dans ce cas précis, le livre est passionnant et plaisant à la fois. Il faut en connaître d'abord les fondements Depuis 1993, Véronique Aubouy tourne un film en vidéo où elle a entrepris une lecture intégrale d'A la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Chaque lecteur se voit confier deux pages. Jusqu'à ce jour elle a plus de cent heures d'enregistrées ! Quant aux lecteurs, ils appartiennent à des couches sociales et à des âges différents : il y a des érudits, des écrivains, mais aussi des paysans et un sapeur pompier ! Cette folle aventure a déjà été présentée encore fragmentaire à « La Force de l'art » au Grand Palais et puis à la Maison de la poésie. Le résultat est absolument étonnant. D'aucuns lisent bien, d'autres ânonnent. Mais le texte de Proust, dans cette polyphonie vocale colorée et même chamarée, prend des accents et des intonations en révélant des aspects qu'on n'aurait pas nécessairement vus. Quant au livre qui relate en partie de cette longue aventure (je ne sais trop comment les auteur ont fait pour l'écrire à deux mains - ou à quatre, comme on voudra), il rapporte des anecdotes révélatrices, fait des portraits de certains de ces lecteurs, pas les gens de lettres, mais ces personnes simples qui se sont prêtés au jeu. Et puis s'y tisse une conception de la lecture et même une manière de vivre la chose littéraire. Proust est audible par tous et pour tous. Il suffit de le vouloir et de gommer toutes les références savantes et universitaires. Bien sûr, on peu lire Proust d'une manière historique, sémantique ou de quelque façon sérieuse que l'on veuille dans le cadre d'un examen critique. Mais il n'en reste pas moins vrai que le texte, lui, est accessible sans enrobage théorique. Bien sûr, comme A la lecture le montre, il faut s'appliquer à l'amour de cette fiction qui va à la rencontre de notre vécu (le vécu de tout un chacun), en toute liberté, selon sa sensibilité et son expérience. C'est un beau livre, riche d'enseignements, émouvant, plein d'imprévus, et qui est une invitation au voyage dans le texte.
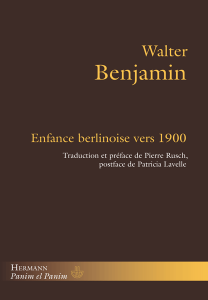
Enfance berlinoise vers 1900, Walter Benjamin, traduction et préface de Pierre Rusch, post-scriptum de Patricia Lavelle, Hermann, 158 p., 15 euro.
Walter Benjamin est sans doute l'auteur le plus remarquable pour n'avoir jamais écrit un livre au sens plein ! Il s'est bien essayé à la nouvelle, mais sans grand succès. Il n'était pas fait pour la fiction. Cela ne l'a pas empêché d'exercer de son temps et d'exercer encore une influence considérable car les écrits qu'il nous a laissés sont remarquables et encore, pour la majorité de ses essais littéraires, d'une actualité pleine et entière. Cette Enfance berlinoise est la troisième version d'un opuscule qu'il n'a jamais publié de son vivant. Celle-ci est la dernière car elle a été écrite à Paris entre 1938 et 1939. C'est court et concis (comme il aimait le faire) car chaque chapitre est dédié à un objet (le téléphone ou la chaussette, par exemple) ou à un lieu (la cour de son école). Benjamin déclare qu'il a mis en chantier ce projet en 1932 quand il a commencé à comprendre qu'il allait devoir sous peu quitter sa ville natale, sans doute pour toujours (ce qui a été, hélas, le cas). Il collectionne donc tout ce qui a pu le frapper. Bon nombre de ses contemporains auraient rédiger un « roman familial » ou au moins un roman d'initiation. Lui, il se contente d'élire des moments, des endroits importants à ses yeux (et la plus part du temps insignifiants aux yeux d'autrui !) ou des choses qui ont joué un rôle de premier plan dans cette partie de son existence. « La Lune » ne saurait faire l'objet d'un chapitre en coupe réglée ! Quelques pages suffisent. Et c'est valable pour cette autobiographie assez peu autobiographique. Pourtant, dans chaque petite section, il révèle beaucoup de lui-même. Mais pas dans les termes d'une confession. On découvre quelques rues, une poignée de monuments de Berlin, mais finalement peu de choses et surtout des choses de la vie courante. Mais c'est le regard de l'enfant qu'il parvient à nous transmettre et cela est une pure merveille.

Le Studio d'Yves Saint Laurent, Jéromine Savignon, Actes Sud, 144 p., 18 euro.
Ce volume est tout à fait plaisant et intéressant. L'auteur nous entraine non dans l'intimité du grand styliste, dans son univers de créateur. On suit Yves Saint Laurent dans sa carrière fulgurante chez Dior et de nombreux documents photographiques, qui ont été choisis avec soin et discernement. Bien sûr, il y a une tendance dans ces pages à faire de ce grand personnage une sorte de saint. Une forme d'adulation est manifeste. Mais, en fin de compte, ce n'est pas grave étant donné qu'on éprouve de plaisir à revivre ce parcours exceptionnel qui a fait de lui un dieu vivant de la mode française et l'une des personnalités les plus marquantes de l'après-guerre. La maquette vient à point nommé sous-tendre ce projet nostalgique de l'époque où ce jeune homme à lunettes habillait les femmes de tableaux célèbres !

Epiphanies, Jean-Michel Othoniel, texte de Catherine Grenier, Actes Sud, 124 p., 25 euro.
Catherine Grenier se donne beaucoup de mal à trouver une légitimité aux oeuvres de M. Othoniel. Elle va la chercher dans la religion catholique. Elle dénote même dans sa démarche un passage du reliquaire à la relique. Elle n'hésite pas à citer l'abbé Suger, l'ennemi juré de saint Bernard, qui voulait que l'Eglise soit un écrin précieux pour le divin. (Mais souvenons qu'il y a en jeu la commande du choeur de l'Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay). Eh bien, j'applaudis des deux mains : ce champion du kitsch postmoderne, ce héraut incontesté du rococo naïf dans l'art contemporain est élevé au rang des grands bâtisseurs de cathédrale ! La conservatrice a fait ce qu'elle a pu, manifestement en toute hâte. Maintenant voyons ce qu'il a fait de beau (façon de parler) : on retrouve toujours son goût immodéré pour les guirlandes de Noël et pour l'ameublement d'un Ségalot du l'hallucinatoire, tout en s'affirmant un saint-sulpicien de premier ordre ! Il y a bien d'autres tentatives, certaines qui ressemblent à ce que fait Georges Rousse, et d'autres, avec des effets de couleur qui ne désavouerait pas Morellet. Mais pas grand chose de neuf dans ce magasin à produire des effets de rideaux de cabanon marseillais. Alors il essaye de mettre sa quincaillerie dans des forêts épaisses pour jouer un peu à son Pennone, il puise à droite, il puise à gauche, mais nous en sommes toujours au même point : la boule de sapin (il faut d'ailleurs se souvenir qu'après la chute de l'Union soviétique, les ouvriers russes ont été payés avec des boules de ce genre !)- Othoniel fait parti de ces artistes qui plaisent aux « grands collectionneurs actuels », qui sont d'abord de grands spéculateurs. Plus c'est abominable et plus l'oeuvre a de la valeur. Vous voulez en être convaincus ? Alors lisez la revue Artkey. Il ne s'agit plus d'être doué et inventif dans son ouvrage pour devenir un artiste cher. Jeff Koons, qui ad es rétrospectives de-ci et de-là dans les plus grands musées a enfoncé le clou : plus c'est grotesque, ridicule et laid, plus on s'enfonce dans un académisme du clinquant, et plus on a l'espoir de se rapprocher de la sainte table. Othoniel est en bonne voie.

Terrestres, Guy Oberson, poèmes de Nancy Hudson, Actes Sud, 164 p., 29 euro.
J'ignore qui est Guy Obserson. Mille pardons. Mais ce n'est pas si grave. Ce volume me fait découvrir son oeuvre. Ses peintures, ses dessins, ses sculptures, traitent tous d'un même sujet : la nature. Bien. Cette nature a, chez lui, une apparence un peu sinistre : des crânes d'animaux, surtout des bovidés et des cervidés (il a une prédilection pour les bois de cerfs), des ciels noirs comme de l'encre, au bord d'un orage effrayant. Et quand il s'approche de l'être humain, c'est pour nos exhiber des têtes d'enfants morts nés ou hydrocéphales, ou frappés par un mal encore plus épouvantable ! C'est un monde de mort. D'ailleurs, l'oeuvre qui lui a été inspirée par Holbein (Homme à la morgue) donne parfaitement le ton. Mais je n'ai rien contre. Le monde n'est pas idyllique et nous ne vivons pas à l'Age d'or, loin s'en faut. Mais ce que je n'aime pas dans son travail, ce sont ces coulures, ces barbouillages, qui sont censés donné une allure de modernité à ses compositions qui, somme toute, sont assez académiques. Le plus grave, c'est ce qu'accentuent les textes poétiques de Nancy Hudson. Voilà un écrivain qui devrait se dispenser d'écrire autrement qu'en prose. Celle-ci ne me plaît pas beaucoup non plus, mais elle « sait faire ». C'est parfois risible car elle accentue le trait et rend ce qui est déjà assez peu alléchant franchement rébarbatif -, ou comique ! Drôle d'histoire que celle que nous raconte cet artiste. Mais l'histoire vraiment drôle et la poésie bavarde de l'auteur de Ligne de faille.
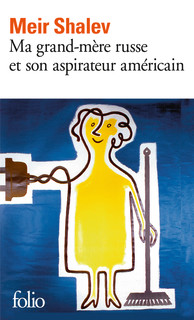
Ma grand-mère russe et son aspirateur américain, Meir Shalev, traduit de l'hébreu par Sylvie Cohen, Folio, 288 p., 7,40 euro.
Ce roman est de caractère autobiographique. L'auteur raconte l'histoire de ses grands-parents qui sont partis en Palestine pour participer à ce qu'on n'appelle pas encore un kibboutz, mais une coopérative agricole. L'action se déroule dans une zone rurale de la Galilée, à Nahaval, et on découvre un cercle familial marqué par le sionisme et le socialisme étroitement associés dans une même idée du mari et l'obsession maladive de la propreté de son épouse. Le livre est drôle, bien sûr, parce que le frère du mari, qui est resté aux Etats-Unis et est devenu un adepte du capitalisme pur et dur, a l'idée de leur envoyer un aspirateur, ce qui, à l'époque, était un engin ultra moderne. Dans ce petit monde qui vit durement du travail de la terre avec des moyens rudimentaires et pauvres, l'arrivée de cette machine est un événement. Et la grand-mère de l'auteur couve jalousement son appareil ménager ! Au-delà de cette histoire savoureuse à rebondissements multiples, on découvre la vie des pionniers qui sont arrivés dans la terre ancestrale avec leurs idéaux et cela jusqu'à la déclaration d'indépendance d'Israël. C'est un livre qui se lit avec plaisir, avec intérêt, qui fait souvent rire malgré l'arrière plan qui n'est pas toujours des plus fameux.

Art Orienté Objet, Chloé Pirson, Marion Laval-Jeantet & Benoît Mangin, Musée de la chasse et de la nature, 144 p., 19 euro.
Ce très beau catalogue de l'exposition personnelle de Chloé Pirson révèle la démarche complexe d'une artiste qui s'est attachée à la réalité mécanique, physiologique et dynamique du monde animal, et aussi à la relation de l'homme face à ces bêtes qui nous entourent ou qui surgissent d'un passé lointain. Son histoire est strictement conceptuelle, ce qui fait la limite de certaines de ses installations. Mais, pour l'essentiel, elle a tenté de recréer les liens imaginaires ou mythiques qui nous lient à l a nature. Certaines pièces sont très belles et parlantes sans grands discours. The Year my Voice Broke (le cerf), 1996-1997 ou Trans-fusion (2013). Les commentaires sont très clairs et offrent un éclairage indispensable sur ces oeuvres qui se posent souvent comme des énigmes. A mes yeux, la création la plus percutant est sans nul doute Un aigle et une colombe se transforment l'un en l'autre ou La chasse mazera (2013). C 'est spectaculaire, certes, mais d'une grand intensité. Au-delà des tics du langage artistique de notre époque, l'artiste est parvenue à rendre avec force les forces en puissance dans la nature.

Numance, Cervantès, édition et traduction de Jean Canavaggio, « Folio Théâtre », 208 p., 6,20 euro.
C'est en 1585 que Miguel de Cervantès écrit Numance, ou plus exactement El Cero de Numancia, une pièce tragique (qu'il classe néanmoins dans ses comédies), qui rappelle la résistances héroïque des courageux Numanciens qui sont attaqués par les légions de Scipion au IIe siècle. Il relate cet épisode guerrier en quatre jours, comme c'était la coutume à l'époque et utilise toutes les ressources scéniques du corral, ce qui était la scène en Espagne à cette époque. La riche et pertinente préface de Jean Canaveggio nous permet de comprendre non seulement les sources de cette histoire, mais aussi les circonstances de son écriture. L'Espagne de Philippe II est triomphante. L'éloge des défenseurs de la ville de Numance est sans doute possible un éloge de ce roi austère et religieux fanatique, mais aussi l'héritier de Charles Quint. La pièce est lisible et donc représentable encore aujourd'hui, malgré le nombre important de personnages. C'est une oeuvre intense et Jean-Louis Barrault a su l'adapter avec succès après guerre.

L'Excellence de nos aînés, Ivy Compton-Burnett, traduit de l'anglais par Philippe Loubat-Delrans, « Grands romans », Points, 416 p., 7,90 euro.
La France est frappée d'une grave maladie : la manie de tout retraduire : Dante Alighieri, Don Quichotte (épouvantable la nouvelle version), les Mille et une nuits (illisible)... Et là, ce roman publié en 1944 et traduit en 1949 chez Gallimard sous le titre de Nos vertueux aînés prend un titre encore pire. Soit. Quant à l'oeuvre, elle est déconcertante : faites de dialogues, elle conserve de la tradition anglo-saxonne les conflits familiaux (c'est presque ici un feuilleton), mais en introduisant une pincée d' « expérimentation ». L'auteur a une dette à l'égard de Gertrude Stein. C'est ainsi que les détails les plus banals (comme ceux de l'installation des Donne dans leur nouvelle demeure) deviennent savoureux et comiques. Quand le drame entre en jeu (une famille de lointains parents, les Calderon, habite juste à côté) avec la mort de la tante Sukey, les choses gâtent et deviennent franchement désagréables. Peu à peu, de néfastes secrets intimes font surface et une guerre sournoise (et sordide) se met en place entre les deux familles. Avec son système narratif, Yvy Compton-Burnett parvient à insinuer de bien vilaines actions sur le ton badin de ces conversations. Elle dépeint un monde qui a perdu ses valeurs, enfin celles qu'on lui prête pour le passé. C'est habile, mais parfois ce bavardage systématique prend la forme de grosses ficelles littéraires.
|
