
La Bible et les saints, Gaston Duchet-Suchaux & Michel Pastoureau, « Art les essentiels », Flammarion, 320 p., 19 euro.
Cette nouvelle édition de ce manuel présente une nouveauté curieuse : presque plus d'iconographie ! C'est fort regrettable car la représentation des patriarches et des saints a été abondamment illustrée et formalisée par les peintres au fil du temps. Il n'en reste pas moins que c'est un livre qui est d'une utilité indéniable. On n 'est pas pris au dépourvu quand on vous demande ce qu'est la « Vierge pastourelle » ! Il n'est pas complet, bien sûr, car il faudrait alors une véritable encyclopédie. Mais il est assez riche pour qu'on puisse y retrouver facilement ce qu'il faut savoir sur saint Jérôme ou saint Augustin. Les notices sont bien faites et tout étudiant en art ou tout historien d'art doit la posséder pour se faire une idée générale de cette figure, qu'elle fut réelle ou imaginaire, qu'elle ait été soumise ou non à des métamorphoses iconographique au fil des longs siècles de l'existence de l'Eglise catholique.
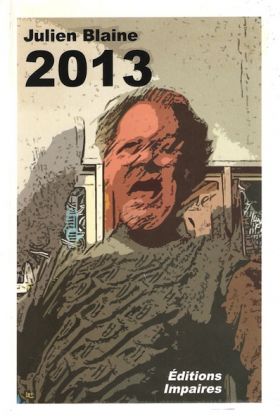
2013, Julien Blaine, Editions Impairs, s. p..
On peut dire une chose avec certitude à propos de Julien, c'est qu'il est prolixe. Presque autant que Michel Butor ! Mais l'oeuvre qu'il poursuit a une logique interne qui nécessite ce débordement. N'étant pas un descendant en ligne directe de Marcel Duchamp, il n'a pas besoin de produite un chef-d'oeuvre tous les dix ans, avec la plus extrême parcimonie. Non, son oeuvre est un bouillonnement d'idées et de jeux de mots, de rapprochements insolites, de créations de sens et d contresens. Dans ce fort volume, qui peut être regardé comme une anthologie de ses créations récentes, le principe de base reste : la poésie et l'art ne connaissent pas de frontières. La poésie est bafouée et l'art est niqué. S'il envoie l'Art au-delà ce qui est acceptable avec un esprit Dada rabelaisien, il ne pense pas avoir atteint les sommets de la réussite. Au contraire. Ses textes sont taraudé » par le doute. Tout le début du livre peut être compris comme une autocritique et aussi la manifestation de ce qu'il ne considère pas comme un accomplissement. Sa quête n'est pas terminée. Il cherche encore les régions inconnues où il pourrait trouver ce qu'il cherche. Sans doute, déconstruire les formes poétiques et artistiques, c'est une sorte de gageure, car c'est le jeu tragique de « à qui perd gagne ». Ses cartes postales, photographies, détournements, pastiches, listes (j'en oublie des dizaines et des dizaines), sont autant de façons de nier ce qu'il affirme -, sa vérité d'écrivain, sa vérité de créateur. Moi, j'ai ressenti ce livre comme une sorte d'autobiographie au-delà du plaisir qu'il nous offre et des rires qu'il provoque. C'est follement drôle, irrespectueux, délirant et déconcertant. Mais c'est aussi là où nous en sommes. A un point où tout risque de basculer. Cul par-dessus tête. On le sait bien : la littérature ne va pas périr sous ses coups de boutoir et l'art trouvera toujours le moyen de se retomber sur ses pattes. Blaine n'est pas un nihiliste. Il vit ce que vivent tous ceux qui veulent allez le plus loin possible dans la tradition du nouveau. C'est une joyeuse danse au-dessus du volcan, sans filet. Et on ne pourra jamais oublier que ses ouvrages antitout, sont des inventions qui finiront dans un musée ou dans un autre. Saint Fluxus, priez pour nous, qui sommes de bien tristes truqueurs ! Il y a des merveilles dans ce volume. Sortez-le de leur contexte. Il joue avec le feu, c'est vrai, mais il lui arrive bien des fois de surprendre par ce qu'il a imaginé et qui possède sa beauté, aussi dérisoire soit-elle.

Plaisirs et bonheur, Montesquieu, « Folio sagesses », 96 p., 2 euro.
Tous ces textes ont été extraits des Pensées de Montesquieu. L'idée est excellente de faire partager au lecteur le meilleur des considérations de Montesquieu. Mais il y a tout de même un problème : quand on aborde la partie baptisée « esprit », les fragments choisis semblent être des aphorismes. Or l'auteur des Lettres persanes est tout sauf un homme doué dans ce domaine. C'est justement une autre conception de l'esprit qu'il entend mettre en jeu, et non des bons mots et des formules à l'emporte-pièce. Quand il déclare : « Deux sortes d'hommes : ceux qui pensent, et ceux qui s'amusent », pourquoi pas ? Mais sortie de son contexte, cette confrontation fait un peu pâle figure. Il y a d'ailleurs pas mal de vérité par toujours bonnes à dire dans ces pages ! Mais prises de cette façon, on a l'impression d'une collection de certitudes avancées avec aplomb. Non, Montesquieu a glissé ces petites phrases parfois assassines dans un texte pour qu'elles y trouvent leur force et leur valeur. Mais pour le reste, c'est un régal, par exemple, le passage sur les affections. Mais là, ce sont souvent de longs paragraphes...

Le Désir et les dieux, Yves Bonnefoy, Françoise Frontisi, Jérôme Delaplanche, Flammarion, 276 p., 35 euro.
Cet ouvrage reprend le principe des manuels (d'ailleurs fort utiles) qui traitent des grands sujets de la peinture. Avec l'abolition de la littérature latine dans les lycées, il est évident que le lien qui existaient entre nous et le monde antique s'est largement effrité. Les grands mythes, qui ont été narré par d'illustres auteurs de ce temps comme Ovide ou Hésiode ne nous parlent plus. Quand nous nous retrouvons devant un tableau représentant Léda et le cygne, la plupart d'entre nous sont embarrassés. Les auteurs de ce livre nous racontent avec beaucoup d'intelligence et de méticulosité la réalité de ces mythes. Bien sûr, il est impossible de décrire les innombrables versions de toutes ces histoires qui ont alimenté l'histoire de notre peinture. Mais les choses ont été faites avec discernement, en partant des versions les plus utilisées pendant la Renaissance et le baroque. De plus, les peintres ont souvent aimé transformer les mythes anciens à leur goût. C'est un autre aspect de la question qui est traité ici : ces mythes ont poursuivi leur existence imaginaire dans notre culture dès qu'on a pu les reproduire. L'excellente préface de Bonnefoy s'est donnée pour mission de montrer comment a évolué la relation de l'humanité classique et des dieux de l'Olympe, mais aussi une fois qu'ils ont été chassés de l'empyrée par le christianisme. Ils prennent alors des formes allégoriques ou symboliques. Par exemple, on a commencé par représenter Louis XIV sous l'aspect d'Hercule. Puis on a préféré le rapprocher d'Alexandre le Grand. C'est valable pour la plupart de ces représentations. En somme, ce livre nous fait comprendre l'essentiel de ce mécanisme qui se sont développés jusqu'à une date récente...

Paul Durand-Ruel, le pari de l'impressionnisme, RMN /ML Sénat, 240 p., 35 euro
Mémoires du marchand des impressionnistes, Paul Durand-Ruel, Flammarion, 332 p., 32 euro.
Durand-Ruel, Claire Durand-Ruel Snollaerts, « Découvertes hors série » Gallimard/RMN, 8,90 euro.
Le plaisir d'un catalogue est de nous aider à ne pas perdre le souvenir d'oeuvres qui nous ont tant séduit lors de la visite d'une exposition. A part celles que je connaissais déjà, comme Camille de Claude Manet, je n'ai de laisse de regarder ce Lecteur de Manet que je ne connaissais pas. Quelle toile singulière ! Mais en dehors des informations de toutes sortes, nécessaires et suffisantes pour la connaissance du sujet, il y a dans ce volume un article passionnant, celui de Jennifer A. Thomson, où elle relate les relations très particulières du marchand de tableaux avec les Etats-Unis. Il avait déjà, comme Goupil, ouvert une galerie à Londres (il la fermera en 1877 après sept ans d'existence) et il avait organisé des ventes aux enchères de l'autre côté de l'Atlantique depuis 1860. Il eut bientôt un grand nombre d'acheteurs américains, dont l'un a acheté tout le stock ! Il a même songé à avoir pignon sur rue à New York et a regretté de ne pas l'avoir fait ! Mais, comme nous l'apprend John Zarobell dans son passionnant essai, Durand-Ruel n'était pas un marchand classique. Il faisait de la spéculation dès 1870 et il a trouvé des alliés (toujours anglo-saxons) pour ce genre d'affaires, surtout un certain Edwards, qui meublait des appartements huppés du boulevard Haussmann en sa possession, et qui les revendait plus tard et dont il partageait les bénéfices avec Durand-Ruel. En fait, Edwards prêtait de l'argent à ce dernier et il se rétribuait sur ces ventes. Grâce à ces liquidités, il a pu lancer une revue (la Revue internationale de l'art et de la curiosité) et faire des acquisitions importantes. De plus, il suivait de près et influençait les salles des ventes. Avec lui, c'est un tout autre genre de travail qui a vu le jour dans le monde des arts.
Mais Paul Durand-Ruel n'était pas seulement un de ces personnages qui aurait pu figurer dans l'Argent d'Emile Zola. Sans être un mémorialiste savoureux et quelque peu truqueur comme Ambroise Vollard, Durand-Ruel a laissé des mémoires absolument indispensables pour comprendre l'art de la seconde moitié du XIXe siècle (édité par ses descendants, de manière remarquable). C'est un gigantesque livre de compte, où il a noté avec soin ce qu'il a vendu et ce qu'il a pu acheter. Il fait de brèves réflexions sur le travail des peintres. Il donne plus de détails sur certains des acquéreurs. Mais c'est le mécanisme des mouvements spéculatifs et des stratégies qui s'y attachent qui rendent l'ouvrage fascinant (et utile pour l'historien d'art). On apprend comment un marchand doit se comporter pour mener sa barque. Dommage qu'il se fut arrêté en 1887, une fois que les Américains avaient assuré définitivement sa réputa ion mondiale (il ne décède qu'en 1922). Notre modernité en art est née bien avant le cubisme. On comprend aussi pourquoi Monet ou Renoir ont fini leurs jours aussi riches ! C'est à ma connaissance la seule source de première main que nous ayons pour analyser ce phénomène. La bourse et le musée commençaient leur lente mais inexorable fusion !
Enfin, le petit volume de la collection « Découvertes » propose une introduction à l'univers de cet homme peu commun qui a fait triompher l'impressionnisme chez les collectionneurs du monde entier.

Querelle autour d'un petit cochon italianissime a San Salvario, Amara Lakhous, traduit de l'italien par Elise Gruau, Actes Sud, 208 p., 20 euro.
Voici un roman qui exprime à merveille ce qu'est la nouvelle littérature italienne. D'une part, elle parle des problèmes nouveaux qui se sont faits jour dans ce pays, en premier lieu l'immigration. Les « extra communautaires », comme on désigne de l'autre côté des Alpes ces étrangers venus chercher du travail de tous les coins du monde, ont créé une sorte de traumatisme : jusque là, l'Italie ne connaissait pas ce phénomène, comme la France par exemple, qui a eu de nombreuses colonies sur tous les continents. D'autre part, il y est question de la nouvelle criminalité qui là aussi s'est diversifiée. L'auteur a choisi la mafia albanaise, qui a pris racine dans le nord de la botte. Enfin, il fait état des problèmes de toutes sortes qui naissent de la cohabitation difficile entre les diverses religions, et surtout entre l'Islam et le catholicisme. L'anecdote du petit cochon est drôle et absurde, mais elle révèle bien de quoi il est question. A toutes ces questions sociales et culturelles vient s'ajouter dans ce livre le nouvel esprit de la presse italienne, qui devient une presse à sensation et n'hésite pas à faire passer des nouvelles qui sont soit fausses soit truquées, soit faites pour agiter les esprits. Le journaliste calabrais qui vit à Turin est l'archétype de ce nouveau genre de journalisme sans foi ni loi. D'une histoire criminelle hélas devenue banale, il tente de monter une affaire beaucoup plus importante, avec des ramifications politiques. Je dois reconnaître que le livre est drôle et que l'histoire est bien montée, avec humour et un sens critique prononcé. Mais c'est d'une certaine manière transformer dans le roman ce qu'il condamne dans le monde de la presse. C'est un enquêteur sur un faussaire du journalisme ! Bien sûr on lira ces pages avec plaisir et avec intérêt. Elles ne manquent pas leur but car l'auteur a un certain talent. Mais, une fois lu, on se dit : bien, c'est l'Italie en pleine déliquescence qui nous est décrite. Mais cela fait-il de ce livre un roman digne de ce nom ? C'est de littérature éphémère, qui n'e conservera qu'un intérêt sociologique par la suite. C'est là sans doute la conséquence de l'esprit de ce pseudo groupe des cannibales, qui au lieu de renouveler la littérature transalpine l'a réduite à faire des « coups » pour frapper l'imagination et en oubliant ce qui devrait faire son essence. On ne peut pas reproduire Balzac, Zola et De Amicis a perte de vue. Mais on peut aussi inventer une littérature avec une perception plus vaste du monde.
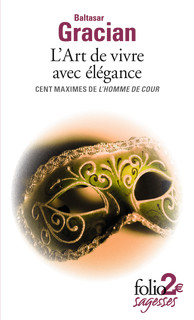
L'Art de vivre avec élégance, Baltasar Gracian, « Folio sagesses », 118 p., 2 euro.
Batalsar Graciàn y Morales (1601-1658). Cet Aragonais a fait partie de la compagnie de jésus et cela se sent ! Il a été le confesseur du duc de Nocera et fut ainsi introduit à la cour de Philippe IV. C'est là qu'il écrit ses premiers ouvrages, le Politique Don Fernando (le vice-roi qui va tomber en disgrâce !) et El discreto, qui a été traduit par l'Homme universel et L'Homme de cour (1646). La publication en trois parties du Criticon lui a valu l'exil à Graus. Tout l'a dit : il a été regardé comme le Machiavel du XVIIe siècle. Et ce n'est pas entièrement faux, si ce n'est que le Criticon constitue la critique ce qu'il avait pu louer dans ses oeuvres précédentes. L'Homme de cour fait exception car c'est en fin de compte un livre sur la meilleure façon de vivre dans la bonne société en cultivant les vertus les plus hautes. Ce que Graciàn énonce pour son époque vaut le plus souvent pour notre univers. Ce livre n'a rien perdu de sa valeur ni de sa sagacité.

La Voix de Pistoletto, Michelangelo Pistoletto & Alain Elkann, entretiens traduits de l'italien par Matthieu Bameule, Actes Sud, 386 p., 25 euro.
Ces entrevues entre l'artiste italien Michelangelo Pistoletto et Alain Elkann sont tout à fait intéressantes. Moi, j'aurais préféré un livre rédigé car ce sont des questions brèves et aussi des réponses courtes. Mais enfin, on y apprend une foule de choses sur ce créateur, qui est une des grandes figures de l'Arte povera. C'est une autobiographie dans le plus menu détail, mais aussi une suite de réflexions qui vont de la religion (cela commence d'ailleurs curieusement par cette question !) , et elle passe par toutes les phases de son oeuvre. Il ya bien longtemps que Pistoletto a son oeuvre derrière lui : sa prestation à la Biennale de Venise avec les grands miroirs fendus il y a trois ans l'a hélas démontré. Mais ce n'est plus une jeune homme (il est né en 1933). Il explique avec clarté ses intentions esthétiques, guidé par un interlocuteur qui connaît très bien son travail. Je reste sceptique sur son Troisième Paradis (on le voir en train de creuser des sillons avec le soc d'une charrue : cela fait trop penser à Joseph Beuys !) Mais pour le reste, ce livre est sans doute la meilleure façon de comprendre ce qui a pu le guider dans ses recherches pendant si longtemps et avec une telle opiniâtreté. Le bon revers de la médaille est que ce système de questions et de réponse rend la lecture du livre extrêmement aisée et plaisante.

Des moyens de la sagesse, Tang Zhen, « Folio sagesses », 112 p., 2 euro.
Ce petit recueil nous rappelle la différence abyssale entre la pensée occidentale et la pensée extrême-orientale. Même en matière de religion. Tout ce qu'énonce l'auteur est à mille coudées de ce que nous pouvons faire et comprendre. Cet homme qui a vécu pendant la seconde moitié du XVIIe siècle était un savant. Il a connu la chute de la dynastie Ming et a servi comme haute fonctionnaire au début de la dynastie de Mandchous. Ses considérations sur le rapport de l'homme et du monde et qui constitue le fondement de la sagesse ne saurait se rapprocher de rien de ce que nous appelons « philosophie », même des stoïciens. Le lire, c'est lire une langue étrangère, une pensée étrangère, une autre manière de percevoir les choses qui nous échappent. Peut-être cela peut nous servir à voir les failles dans notre mode de considérer ce qui nous entoure.
|
