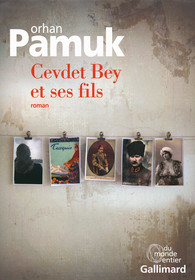
Cevdet Bey et ses fils, Orhan Pamuk, traduit du turc par Valérie Gay-Askoy, Gallimard, 766 p., 25,90 euro.
Voici le premier roman publié par Orhan Pamuk, l'écrivain turc qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2006. Publié en 1982, puis remanié en 1995, cette très longue oeuvre romanesque montre bien les ambitions de l'auteur : ne pas chercher dans l'histoire les ressorts de ses intrigues, comme Tolstoï, par exemple, ni traquer les circonvolutions psychologiques de ses héros pour les décrire comme l'avait fait Pirandello, Svevo ou Strindberg. Et pourtant, Pamuk choisit trois moments clefs de l'histoire de son pays pour marquer l'histoire des trois personnages principaux de sa fiction : 1905, quand l'Empire ottoman, déjà à son déclin, ente une timide démocratisation parlementaire à l'époque du sultan Abdülhamid II (dont le règne se terminera par un coup de force raté des religieux), la fin des années trente (Atatürk meurt en 1938), quand la menace de la guerre se fait oppressante et que nul ne sait ce que la Turquie moderne va faire, enfin 1970, quand les militaires font un coup d'Etat à l'aube de la démocratie. Cevdet Bey est un homme curieux, plein de contradiction, qui avait choisi le commerce non seulement comme travail, mais aussi comme bannière morale. Il avait écrit sur son établissement « Gevdet et fils » alors qu'il n'était pas encore marié et qu'il n'avait pas d'enfants ! La fortune pour lui a été de devenir l'ami du pacha, qui lui fit épouser une de ses filles. Sa fortune était faite. Ses descendants vont prospérer en dépit des transformations radicales du pays et ils vont arriver à la troisième génération quand les militaires s'emparent du pouvoir. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a peu d'événements saillants, encore moins de drames. Pamuk mise tout sur la dynamique de l'existence et des destins qui se croisent. La vie d'Istanbul et la vie dans les maisons de cette famille aisée. Il est à noter qu'il fait quasiment abstraction de quatre guerres : les deux guerres des Balkans, la Grande Guerre et le guerre d'Indépendance. You s'inscrit en filigrane dans une apparente normalité des faits et des gestes de ses personnages, de leurs rêves, de leurs déceptions, de leurs destins. Il est parvenu à faire un tableau synoptique de la Turquie par petites touches impressionnistes alors que le grand roman, sans rien d'épique ou de dramatique, n'est qu'un roman familial révélateur de la pensée que l'auteur s'est faite des années précédents la chute de l'Empire ottoman et celles qui suivent la création de la République. Il y a des lenteurs, sans doute des moments moins forts, mais Pamuk possède déjà cette force incroyable qui transforme le plus banal et le plus simple en un élément essentiel au puzzle de son récit. Il n'a pas choisi comme Mahfouz (lui aussi prix Nobel et auteur de génie) de mettre en scène le peuple dans sa réalité la plus nue. Non. Il y a les nouvelles, qui filtrent de temps à autre, et l'existence de ces hommes et des femmes qui, mine de rien, ont forger les bases d'un pays neuf.

Man Ray, Serge Sanchez, « biographies », Folio, 368 p., 8,90 euro.
Man Ray ayant écrit son autobiographie, c'est plutôt son histoire familiale et la saga de sa formation qui nous ont retenus dans ce livre. En effet, ses origines ne sont pas américains. En fait, son grand-père Radnitzky était un colporteur juif de Kiev. Il y menait une vie assez pauvre. Il avait eu un fils, Melach, et il pensa lui faire épouser une jeune fille juive de dix-huit ans, Manya, qui avait été élevée dans la banlieue de Minsk. Bien que le mariage n'ait pu se faire tout de suite Melach et Manya s'écrivaient. Après l'emprisonnement et puis la mort de son père, Melach et sa fiancée décident de partir en Amérique et c'est là-bas qu'ils se sont mariés. Ils ont vécu en Pennsylvanie et c'est alors que naquit leur premier enfant, Emmanuel, en 1890. En 1897, la famille s'est installée à New York. Avec ses frères et soeurs, Emmanuel, qu'on surnomme Mannie, fait ses études tandis que son père faisait des gilets sur mesure dans leur appartement ! En grandissant, il s'est révélé un garçon curieux de tout et s'est intéressé plus que tout au dessin industriel. Bientôt, étant donné ses dons, on le destine à l'architecture. Mais finit par choir une activité beaucoup sérieuse la peinture ! Il parvient à s'inscrire dans une école privée, la Ferrer School, découvre l'Ashcan School, visite la première exposition des indépendants, les expositions de la galerie de Stieglitz, puis celle de l'Armory Show. Son enthousiasme est loin de décliner, au contraire. Il devient alors l'ami de Marcel Duchamp et songe à aller à Paris. Il s'est donné un pseudonyme, Man Ray, qui faisait plus américain et a publié dans la revue de Stieglitz. Il a même décidé de fonder une petite colonie d'artistes dans le New Jersey et y a créé un groupe éphémère, The Glebe. En 1914, il fait sa première exposition personnelle : c'est une échec total. Par chance, un avocat, riche collectionneur, a acheté quelques unes de ses oeuvres alors qu'on les remballait. Deux ans plus tard, il fait une seconde exposition, beaucoup radicale. Mais la guerre qui est déclarée en 1917 met un terme à cette belle saison de l'avant-garde. Man Ray participe au groupe Dada de New York. Il crée en 1920 la Société anonyme avec Duchamp et ses connaissances. Il se met à la photographie et lit Tzara. Un an plus tard, il arrivait au Havre... L'auteur a su décrire son aventure de jeunesse avec justesse et de clarté. Cette biographie n'est donc pas un objet superfétatoire.

L'Atelier des Strésor, Cécile Oumhani, Elyzad, 166 p., 14,90 euro.
L'histoire que nous relate Cécile Oumani est celle d'un peintre nommé Henry Stésor. Il a travaillé dans l'atelier parisien des frères Le Nain. Il était né à La Haye et y avait fait son apprentissage. Très tôt, il a éprouvé le désir de partir, d'aller à Paris ou de parcourir l'Italie. La guerre de Tente ans et ses conséquences désastreuses n'avait fait que précipiter son départ. Il retrouve dans la capitale française un oncle qui a un atelier. Il y est reçu. Il fait d'importante découvertes, comme les gravures de Jacques Callot, se perfectionne, ne cesse d'apprendre. Chez Louis Buart, il rencontre sa fille, Catherine, dont il s'éprend. Mais il est réformé et elle catholique. Louis Buart lui demande instamment d'abjurer. Il finit par accéder à ses exigences et il peut se marier. Par malheur, leur premier enfant meurt en bas âge et Catherine est inconsolable. Mais Paris est loin d'être idyllique : les rigueurs de l'hiver, les inondations, les événements tragiques qui s'y déroulent, n'entament pas la passion de l'artiste. Une petite fille vient consoler le couple de leur premier deuil. Son passé, ses rêves et sa réalité ne cesse de se confondre, dans une sorte de danse vibrante. La petite Anne-Renée va grandir et apprendre les rudiments du métier de son père, qui se montre toujours plus furieux de réaliser des tableaux d'une véritable grandeur. Elle est une des premières femmes à être reçue à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Catherine, elle, meurt en 1679. Ecrasé de chagrin, Henry meurt la même année après avoir raconté des bribes de sa jeunesse. Anne-Renée doit surmonter ce drame et aussi ne pas succomber à la tristesse du départ de celui qu'elle aime, parti au Canada. Elle apprendra plus tard qu'il est devenu chartreux. Le passé, le présent et le futur ne cessent de se moduler dans l'espace de cette belle fiction. Jusqu'au moment où l'on découvre que Henry Strésor a vraiment existé, tout comme sa fille... C'est un très beau roman, qui exhume un peintre inconnu (on attribuait ses oeuvres aux Le Nain, dont son portrait de l'abbé Olier et pour son Mangeur d'huîtres) Il est rare qu'on écrive avec tant de tact de finesse sur l'art de la peinture, ou plutôt sur les sentiments qu'elle fait naître chez celui ou celle qui s'y donne. Considérée comme une excellente miniaturiste Anne Strésor est reçue à l'Académie en 1673 et figure dans le livre d'Octave Figière, paru en 1885.

La Splendeur, Régine Detambel, Actes Sud, 192 p., 19 euro.
Je reconnais avoir un faible pour les ouvrages de Régine Detambel. Avant d'en ouvrir un nouveau, comme c'est le cas de la Splendeur, je sens un petit pincement au coeur. Que vais-je y découvrir ? Cette fois, j'y trouve l'univers trouble du XVIe siècle, avec toutes ses ambiguïtés. Mais surtout un jeu ambigu entre la science et tout ce qui est occulte, alchimique, mystérieux. Au centre de ce livre sulfureux, une figure imposante, celle de Girolamo Cardano, un homme qui a passé pour être un grand médecin et a écrit un nombre d'ouvrages curieux pour nous, qui vivont au XXIe siècle. Il est appelé à la cour du roi Henri de France et dans différentes cours d'Italie. Ce maître de la mathématique et de l'astrologie finit par tomber de son piédestal à cause d'ennemis jaloux et malveillants et il risque les rigueurs impitoyables de l'Inquisition. C'est dans une langue riche et foisonnante que Régine Detambel nous brosse le portrait de cet homme d'exception, qui a incarné les grandeurs et les faiblesses d'une époque si riche et si intense, mais frappé par des tares profondes - la superstitions, les conflits religieux, la fragilité des corps face aux maladies, la versatilité des puissants. Son ouvrage est souvent beau et saisissant. Le récit a une tournure picaresque car il ne suit pas un tracé linaire. Son écriture rend avec une incroyable force une époque si loin de notre sensibilité. Tout paraît démesuré, excessif, d'une violence inouïe et pourtant d'une vérité et d'une intensité peu communes.

Henry Bauchau, sous l'éclat de la Sybille, Myriam Watthew-Delmotte, Actes Sud, 240 p., 23 euro.
Je dois avouer, à ma grande honte, que je n'avais jamais lu Henry Bauchau et que je ne connaissais même pas son existence. Je trouve la chose d'autant plus grave que cet écrivain a vécu quatre-vingt-dix-neuf ans ! Mais dans un monde littéraire où il faut faire semblant de tout connaître, je préfère avouer mon manquement. La vie d'Henry Bauchau est tout à fait passionnante, mais elle est malheureuse. La psychanalyse, avec laquelle il a affaire peu après la Libération, avec Anne Bergeron, l'épouse de Pierre-Jean Jouve, semble avoir déterminé le cours de sa relation à l'écriture. Ce qui me gêne dans cette étude, c'est ce penchant au panégyrique, qui est encore accentué par les chapitres intercalaires qui sont des odes laudatifs. Devant une oeuvre aussi importante, le biographe a mis en avant la poésie et les journaux, qui fausse, à mon sens, la perspective dans laquelle placer cet auteur. En effet, on a l'impression de ne pas avoir accès à l'aspect majeur de son travail qu'une fois dépassé un nombre considérable de pages. Au bout de cette lecture, je ne suis pas sûr d'avoir envie de le découvrir. Myryam Watthew-Delmotte en fait trop, est trop près de son sujet et surtout n'en fait pas ressortir ce qui devrait être essentiel pour en comprendre la valeur intrinsèque.
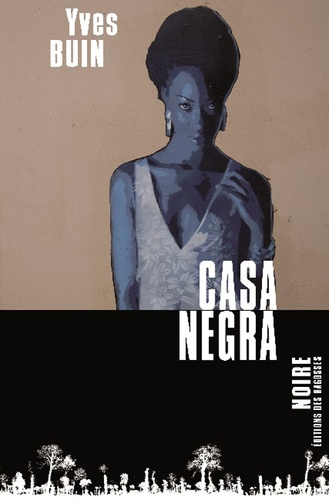
Casa Negra, Yves Buin, « Noire », Editions des Ragosses, 286 p., 13,50 euro.
Ce roman, écrit en l'an 2000, nous révèle un Yves Buin que nous ne connaissions pas. Il emploie un langage parlé, ou tout du moins quelque chose qui s'en rapproche, imagine un histoire à dormir debout qui fait songer aux romans d'espionnage (mâtiné de roman politique), et surtout distille un ton ironique qui est celui du pastiche. Les aventures de Ruby Sandeman et de son ami Bertò, bientôt entourés de personnages de tous les coins de la planète, sont celles d'un petit groupe de conjurés bien décidé (en apparence) à pourchasser les criminels de la dictature sud-américaine des années 70 qui pourchassaient les dissidents dans le monde entier. A mesure qu'on avance dans cette histoire qui paraît toujours plus invraisemblable, on se demande quel est le véritable sujet du livre. Si l'on suit les pas de Sandeman, c'est l'amour de Paris, de ses cafés et de ses brasseries (lieux des réunions innombrables de ces figures étranges), de ses hôtels et de ses multiples secrets, de ses beautés cachés, et de ses aspects lépreux. L'intrigue ne semble qu'un prétexte à toutes ces circumnavigations dans la capitale. Si l'on veut s'attacher à la trame, alors nous sommes confrontés à un conte à dormir debout, picaresque, drôle, où l'attitude des intellectuels « engagés » est sérieusement mise à mal avec un humour mordant. Mais, en dépit de ces curieuses manières d'aborder une fiction, le roman, lui, tient la rampe. Il se lit avec un plaisir infini et on se laisse finalement prendre au jeu. Yves Buin a le don de jouer un double jeu. Et si son héros et ses acolytes se prennent pour des militants accomplissant une tâche morale, aussi absurde soit-elle en fin de compte, nous suivons leurs aventures avec bonheur. Car Buin est un excellent conteur et il sait nourrir son texte de mille remarques pertinentes et sur les personnes et sur les lieux au point de les rendre passionnants.

La Bergère d'Ivry, Régine Deforges, La Différence, 192 p., 16 euro.
Pour ce dernier roman, resté inachevé, Régine Deforges a voulu écrire un livre qui rende un hommage vibrant à Victor Hugo. En effet, elle y raconte un meurtre effroyable, celui d'un jeune homme, qui, saisi de jalousie, massacre sa malheureuse fiancée. Comme tout le monde, Hugo est frappé par l'aspect effroyable de ce crime injustifié. Mais il décide de prendre la défense de ce personnage. Même si ce qu'il affait est impardonnable, il ne mérite pas pour autant la mort. Ainsi, voyons-nous l'auteur des Orientales, encore monarchiste et donc passablement réactionnaire, aller discuter de la question avec ses amis, son aîné Chateaubriand et puis Lamartine, plus tard avec Dumas et Gautier, qui ne partagent pas ses vues. Ce qui est amusant dans ce livre, c'est la description de la vie de Hugo, sa rencontre avec la petite gitane qui deviendra l'Esméralda de Notre-Dame-de-Paris, ses fréquentations dans les cafés et les auberges du Paris de la Restauration à un an de la Révolution de 1830, ses relations conjugales (il soupçonne son épouse de la tromper, alors que lui ne se prime pas de faire des entailles au contrat de mariage). Bref, nous avons un beau portrait de l'écrivain dans sa jeunesse où déjà son génie était patent. Je dois avoir que Régine Deforges s'est très bien tiré avec ce roman. Elle raconte à merveille la gestation du Dernier jour d'un condamné. Qui est plusieurs marches au-dessus de la Bicyclette bleue ! Assez étrangement, il s'achève pour nous à un moment qui aurait pu être sa fin naturelle : la première tumultueuse d'Hernani où une jeune femme s'intéresse à lui, elle s'appelle Juliette Drouet. C'est un plaisir de lire ces dernières pages écrits par une femme qui a été un bon éditeur et surtout une personne courageuse dans son combat contre la censure.

Châtiments, Val McDermid, traduit de l'anglais par Perrine Chambon & Arnaud Baignot, Flammarion, 416 p., 21 euro.
Je ne suis pas un fervent lecteur de romans policier. Mais j'ai lu les grands classiques jusqu'aux thrillers américains des années cinquante. En lisant cet ouvrage de Val DcDermid, j'ai été rapidement frappé par certaines ficelles, comme, par exemple, écrire un chapitre où n'est révélée qu'une seule chose. Le personnage de l'inspectrice Carol Jordan est bien campé et est aussi séduisant. Mais l'horrible criminel, tueur en série, Jacko Vance, semble un cliché. Comme nous vivons dans un monde où l'imaginaire est violent et sans limite, il est violent et sans limite. Ses crimes sont la cause d'une réelle épouvante. Mais ce genre de canevas est lassant. Bien sûr, on lit ce livre à une vitesse exponentionnelle, on ne s'ennuie pas et l'auteur est capable de trouvailles. Mais c'est l'écriture qui pèche. Elle est plate, sans surprise et surtout trop bien lissée. Il n'y a ni humour ni sens de la langage : les assassins parlent une langue enfantine et pas vraiment l'argot ! Dommage.

Darwin, Jean-Noël Mouret, « biographies », Folio, 398 p., 9,40 euro.
Que la famille des Darwin fut étroitement liée à celle des Wedgwood (la manufacture de céramique dont le style et l'esprit ont triomphé dans toutes les cours d'Europe) explique que le jeune Charles Darwin ait pu faire des études en suivant des cours dans des institutions privées à Edimbourg avec son frère Erasmus (son aîné). Très tôt, il se passionne pour les insectes, les minéraux. Puis il se fait installer un laboratoire de chimie dans une dépendance de la maison familiale. Tout d'un coup, ce passionné des sciences veut entrer en religion ! Il espère être admis à Cambridge. Mais ce sera pour étudier la médecine et son frère décide de faire de même. Et il est repris par le démon de la minéralogie et de l'entomologie, ce qui ne l'empêche pas de se faire une solide culture littéraire et musicale. De plus, il adore chasser. Il perd rapidement cette fois née quelques années plus tôt. Mais il veut tout de même étudier la théologie. Il passe ses examens avec succès et décide tout compte fait d'étudier la géologie. Il se met à rêver de voyages et songe à se joindre à une expédition se rendant aux îles Canaries. Mais il se contente de suivre le professeur Sedgwick dans le nord du pays de Galles. En fin de compte, un hasard veut qu'il soit convié à participer à une autre expédition, qui devrait rejoindre la Terre de Feu. Malgré l'opposition de son père, il finit par briser sa résistance et il embarque sur le Beagle en 1831. Sa grande aventure commence et avec elle, la révolution dans les sciences. Cette partie du livre concernant l'enfance, l'adolescence et les années d'université est précieuse pour ne faire comprendre la suite de son existence, que nous connaissons mieux. Cette biographie est bien faite, précise, ne se perd pas trop dans les détails familiaux et les anecdotes. Nous découvrons un homme qui a connu le doute, a eu des certitudes excessives et des élans religieux, brefs mais puissants, et la capacité de réviser son jugement à l'once de la méthode scientifique.
|
