
La Mort de Laclos, Didier Laroque, Editions Champ Vallon, 160 p., 15 euro.
Ce n'est pas un roman à proprement parler, mais un récit, qui aurait fait un chapitre dans un livre-fleuve du XIXe siècle. Mais, par bonheur, la valeur la littérature ne se juge pas à la durée. Aussi court soit-elle, cette fiction a tout pour nous enchanter. L'histoire d'abord de ce jeune officier qui part en mission secrète en Italie, retrouve sa bien-aimée, Giulia, qu'il a épousée sans attendre (il n'a que vingt ans et est sans fortune), sa traversée de la péninsule, les attaques de reîtres tentant de l'assassiner, l'apparition d'un ange gardien, Fusil, qui le sauve de la mort, les étapes de son périples où il voyage déguisé pour arriver à Rome et enfin à Naples, le but de sa mission secrète. Là, il doit se rendre auprès du général Laclos, commandant les artilleurs de la zone campane. Il le trouve sur son lit de mort. Ce dernier lui apprend dans un souffle qu'il est son fils et qu'il lui lègue tous ses biens. Cette histoire est narrée avec soin infini, chaque mot étant pesé avec minutie, mais sans préciosité et sans imité le style du XVIIIe siècle, même si des tournures de phrases ou des vocables sont hérités de cette période. C'est une première tentative romanesque et Didier Laroque y a réussi avec talent. La Mort de Laclos a du charme et du chien et possède surtout cet amour de la narration dont la littérature française est relativement dépourvue de nos jours.

L'An prochain à Grenade, Gérard de Cortanze, Albin Michel, 430 p., 22,50 euro.
Gérard de Cortanze est doté du sens de la fiction d'Alexandre Dumas, de l'imaginaire de Victor Hugo, de l'étrangeté d'Eugène Sue : il ne fait aucun doute que lire un de ses romans est retrouvé un peu de l'esprit du roman historique du XIXe siècle. Mais il se distingue de ses grands prédécesseurs par plusieurs différences de poids, dont son souci de la vérité historique et aussi de la volonté de donner un sens à cette histoire qui ne soit pas un parti-pris personnel, mais une vision embrassant des questions ardues et encore aujourd'hui épineuses. L'An prochain à Grenade manifeste l'intention de l'auteur d'en terminer avec un mythe qui a la vie dure : l'ancestrale entente entre les musulmans et les juifs dont la péninsule ibérique a été l'exemple le plus patent au cours des siècles. Il nous narre l'histoire de Gâlâh, la fille d'un puissant hadjib juif, Samuel ibn Kaprun qui est au service du très redouté Abdar al-Fibri qui règne sur la perle d'Al-Andalus. La confiance d l'émir pour son secrétaire est totale et, au milieu du XIe siècle, la paix règne entre les différentes communautés d'une cité puissante et prospère. Il agite les foules et les incite à la haine raciale et religieuse. Quand à sa file chérie, Gâlâl, elle est devenue très belle. Mais elle est tombée amoureuse d'un jeune poète arabe, Halim. Les jeunes gens doivent se cacher pour se rencontrer. Leur passion est profonde, dévorante. Et Halim lui écrit des poèmes merveilleux. Mais voilà qu'un prédicateur nommé Iblis se met à insinuer que les Juifs complotent contre le pouvoir de l'émir. L'agitation croît et est surtout le prélude à une invasion inattendue : les persécutions qui ont lieu ne sont que le prolégomènes Les almoravides, qui sont d'une intransigeance religieuse absolue, Sachant la fin proche, Samuel donne à sa fille le khomsa, un talisman qui lui permettra de vivre éternellement. La catastrophe arrive : les almoravides s'emparent de Grenade en décembre 1066 et y commettent le spires exactions. L'émir est tué tout comme son fidèle Habjid et Gâlâh fuit avec Halim. Ils finissent par se réfugier à Lucerna. La lame de fond des Almoravides se poursuit et les armées chrétiennes sont défaites. Les deux jeunes gens doivent fuir de nouveau et ils décident de se rendre à Tolède. Halim va mourir de sa belle mort et Gâlâl va poursuivre son périple, chassée par les encore plus sectaires Almohades, se rendant à Lisbonne, à Istanbul, dans tout le monde méditerranéen, et même à Amsterdam, devenant le témoin de toutes les exactions possibles contre les Juifs. De Cortanze, depuis qu'il a découvert son histoire familial et qu'il l'a « romancée », est passé maître dans cet art de conjuguer fiction et histoire.
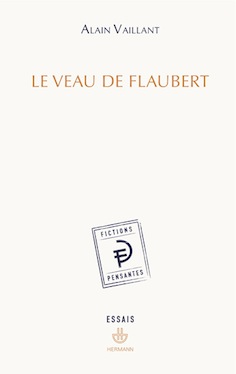
Le Veau de Flaubert, Alain Vaillant, Hermann, 220 p., 23 euro.
Cet essai est à la fois passionnant et désolant. D'un côté, l'auteur prend appui sur Bouvard et Pécuchet et, sur ce socle puisant, tente de mettre à jour l'esprit du comique chez l'écrivain, qui passe par des calembours et des jeux de mots, plus ou moins cachés et en tout cas révélateurs d'un dessein sacrilège Mais pour parvenir à ses fins, il se met à gloser, de la manière la plus universitaire qui soit, c'est-à-dire en commentant les commentateurs - Jean Ricardou par exemple, mais aussi beaucoup d'autres. Le résultat ? Une méditation sur le thème de « veaux, vaches, couvées ». La France rurale du milieu du XIXe siècle paraît émerveiller Alain Vaillant comme si Flaubert n'était pas un provincial. Flaubert décrit le monde qu'il a sous les yeux comme le fera, avec férocité, son cadet, normand lui aussi, Guy de Maupassant. Rien que de très normal que voir les peintres de cette époque peindre des paysages avec des animaux domestiques. Sans doute la montée en puissance de l'industrialisation a sans nul doute rendu les thèmes bucoliques plus attachants pour les artistes et cela va se poursuivre jusqu'à l'Ecole de Barbizon et les impressionnistes. Alors cet incipit incomplet du manuscrit de Madame Bovary ne me paraît pas une piste convaincante : le veau qui, aux yeux de notre auteur, semble absent et qui complètement le nou déjà inscrit à la plume (avec pour résultat nouveau) devient alors le point de départ de digression sans fin sur l'univers des bovins. Les mécanismes du rire qu'il espère nous inculquer sont loin de nous satisfaire, surtout avec Flaubert comme guide. Si ce dernier est un « rebelle », le rire a peu à faire dans Madame Bovary et encore moins dans ses autres livres, même si dans ce premier ouvrage sa virulence peut parfois être drôle et méchante. Si Alain Vaillant avait conduit son raisonnement sur la question sans tous ces détours alambiqués, peut-être serait-il parvenu à nous entraîner à sa suite.

Camus citoyen du monde, Gallimard, 208 p., 29 euro.
La Dévotion à la croix, Albert Camus, « Folio », Gallimard, 224 p., 5,60 euro.
Un cas intéressant, Albert Camus, « Folio », Gallimard, 272 p., 620 euro.
Journaux de voyage, Albert Camus, 144 p., 5,60 euro.
Editoriaux et articles, Albert Camus, « Folio », Gallimard, 784 p., 12,30 euro.
Mon cher Albert, Lettres à Albert Camus, Abel-Paul Bitrois, Gallimard, 88 p., 11,50 euro.
Pour moi, comme pour toutes les personnes de ma génération, Albert Camus a eu un rôle de premier plan : remplacer en partie les fades et insupportables dissertations d'Alain dans nos établissements secondaires. La littérature « philosophique » passe-partout d'Alain est peu à peu oubliée au profit d'une pensée plus fine mais plus ou moins consensuelle. Jean-Jacques Brochier avait écrit en 1970 un petit pamphlet intitulé : Camus philosophe pour classes terminales. Et il n'avait pas tort ! En fait, Camus avait inventé la « nouvelle philosophie » avant l'heure, une manière de discourir sur le monde, avec la légèreté d'écriture des auteurs de la période des Lumières, sans vraiment parvenir à traiter les questions avec toute la hauteur que devrait requérir la philosophie. Il a recherché une troisième voie entre capitalisme et communisme sans jamais la trouver et a su plaire autant aux catholiques (il était athée !) qu'aux marxistes soviétiques ! L'exposition a d'ailleurs très bien rendu l'image du prix Nobel en évitant de trop le mettre en situation désormais historique et en préférant traiter dans le catalogue, métamorphsé en un gentil album, de thèmes divers et variés avec de belles images pour faire passer le tout. C'est tout de même curieux de célébrer le grand homme à la bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence et non au sein des seins à Paris. Voilà un centenaire fêté en grande pompe, mais avec une relative retenue.
Laissons de côté le théâtre de Camus, qui est d'un relatif ennui. Son adaptation de Calderòn, crée à Angers en 1953, est sans doute sa meilleure pièce, en tout cas la plus fluide, beaucoup plus digeste que son Caligula. Mais il ne parvient à retrouver ce que fait la force et la beauté de Calderòn : le sens du coup de théâtre et la langue qu'il faut pour cela. C'est bien écrit et appliqué, mais cela n'a pas de nerf. Quant à l'adaptation du récit de Dino Buzzati, Un cas intéressant, ce qui est déjà chez Buzzati un peu trop prévisible le devient plus dans cette version théâtrale écrite à la va vite.
Les Journaux de voyage ne laissent pas non plus un souvenir impérissable. Ce que Camus nous dit de New York n'est pas très saisissant. Il reste à la surface des choses et ne nous dit absolument rien de la nouvelle culture qui commençait à s'y faisait jour ; quant à l'Amérique latine, tout cela est bien trop rapide.
Restent les articles de Combat, qui, eux, sont brillants. Pendant trois ans (de 1944 à 1947). Il n'est pas un argument qu'il néglige. Directeur de la publication, il peut s'exprimer sans contrainte. Dans ces cent cinquante papiers, il nous offre une image de ce qu'on a pu penser et espérer dans la France à peine libérée pour ce pays, mais aussi pour l'Europe encore en ruines. Et il avance l'idée de changer les conditions politiques auxquelles l'Algérie était soumise. Sans doute n'était-ce pas révolutionnaire, mais, connaissant bien la question, il savait que ce changement était plus que nécessaire. Camus a eu, dans le champ de la politique, une certaine clairvoyance. Mais il n'a pas eu une vision assez vaste et puissante pour comprendre que le monde allait connaître d'autres tourments. Churchill l'avant vu avant que ne se termine la guerre. Camus ne le ressent pas - enfin, pas assez.
En 1970 un ami d'enfance de l'écrivain, qui avait perdu de vue ce dernier en 1931, relate ses souvenirs d'enfance dans le quartier de Bellecourt à Alger. Comme on sait peu de chose de l'enfance de l'écrivain, ce témoignage est précieux. Il est d'ailleurs écrit avec assez de grâce et de finesse. Bien sûr, ces pages inédites ne nous révèlent rien de fondamental. Mais elles permettent de compléter l'idée que nous pouvons nous faire d'Albert Camus.
|
