
Misère et splendeur de la traduction, José Ortega y Gasset, édition bilingue sous la direction de François Géal, postface de J.-Y. Masson, Les Belles Lettres, 124 p., 17 euro.
Ce court essai de José Ortega y Gasset (1883-1955) a été écrit en France en 1936 (il avait quitté l'Espagne en pleine guerre civile) et l'avait envoyé au quotidien argentin La Naciòn. Mais cet essai n'a jamais paru en France. Il l'a présenté comme un dialogue entre professeurs du Collège de France comparable à ceux que privilégiaient les néoplatoniciens de Florence pendant la Renaissance. Il met en avant l'idée de Humbolt pour qui chaque langue possède sa « forme interne ». Contre toute conception utopique, il croit qu'il presque impossible de traduite un ouvrage littéraire d'une langue dans une autre. Il en profite pour faire état de ses vues sur l'utopie positive et l'utopie négative. Puis il met en cause la plénitude du langage par rapport à sa fonction sociale, comme le pensait Meillet. Toute langue possède ses failles (il prend pour exemple le basque, qui n'a pas de mot pour « Dieu » !). Donc la parole ne peut jamais exprimer toute la pensée. Il en vient ensuite à parler de notre civilisation indo-européenne où les choses sont mues par des « agents sexués ». Il en conclue que les langues nous divisent plus qu'elles nous rapprochent. Mais la question centrale demeure la difficulté rédhibitoire de la traduction et de la modernisation des textes anciens. Cette petite méditation est beaucoup intéressante que les considérations de George Steiner dans son gros ouvrage sur la question : il place aussitôt la question au-delà de la pratique de la traduction, mais dans les contradictions de la langue.

La Correspondance de Fradique Mendes, Eça de Queiroz, traduit du portugais par M.-H. Pickwik, Editions de la Différence, 336 p., 22 euro.
202, Champs-Elysées, Eça de Queiroz, traduit et présenté par M.-H. Pickwik, « Minos », Editions de la Différence, 352 p., 12 euro.
Eça de Queiroz (1845-1900) est sans aucun doute l'un des grands écrivains du XIXe siècle. Il mériterait d'être bien mieux connu en France, d'autant plus que la plupart de ses livres ont paru. Ce roman est le fruit de ses rencontres avec ses amis lettrés du Cénacle entre 1868 et 1869. Il imagine alors le personnage de Fradique Mendes, qui est une sorte de dandy baudelairien. Ces premières esquisses lui donnent l'envie d'imaginer l'existence de ce personnage, avec lequel il partage bon nombre de choses en commun. Fradique est fasciné par Victor Hugo et sa Légende des siècles. Le narrateur finit par faire la connaissance de l'auteur des Lapidarìas grâce à un ami et découvre qu'il cultive des idées extravagantes. Il n'en entend plus parler et le retrouve dans un hôtel en Egypte, au terme d'un long périple au Proche et au Moyen Orient. Il le perd de vue puis il le retrouve à Paris. Tous deux « touristes de l'intelligence », ils correspondent. A sa mort, le narrateur rassemble sa correspondance pour la publier. Il choisit seize lettres révélatrices des qualités de cet homme qui a de faux airs du Des Esseintes de Huysmans. Ce livre quia paru l'année même de la mort de l'auteur est un bijou qui révèle la culture du Portugal de son temps et en montre aussi les travers et les aspects ridicules. C'est une petite merveille.
La réédition du roman, lui aussi posthume, d'Eça de Queiroz, 202, Champs-Elysées, permet de comprendre mieux la posture de l'auteur sur les enjeux culturels de son temps. Le narrateur de cette histoire, écrite pendant le séjour de Queroz a Paris à partir de 1888, quand il est consul du Portugal, se nomme Zé Fernandes. Il fait la connaissance à Lisbonne de Jacinto, personnage fascinant issu d'une très riche famille. Celui-ci est un dandy, mais qui est aussi un érudit et un moderniste passionné par toutes les inventions possibles et imaginable, du téléphone au gramophone, en passant par toutes les merveilles de la technique la plus sophistiquée. A l'inverse de Des Esseintes, ce n'est pas un reclus, qui fuit la fréquentions de ses contemporains. De plus, il ne crée pas une esthétique pure. Il aime se promener dans sa voiture, fréquente l'opéra et ne dédaigne pas les promenades, par exemple à Montmartre. Ce n'est pas un mélancolique, mais seulement un esprit curieux, un « énergumène » aux goûts raffinés. Zé Fernandes est convié à vivre à Paris et y trouve son plaisir. Mais, contrairement à son ami, il n'est pas pris par le vertige du monde qui se transforme à grande vitesse. Et lorsque les deux amis voyage au Portugal, il parvient à le convaincre des charmes et de la beauté de la vie dans la campagne de leur pays. Mais ce deux mondes qui s'éloignent sans cesse plus, l'auteur de les oppose pas comme si l'un représentait le bien et l'autre, le mal. Avec une pointe de rousseauisme, il plaide pour les valeurs qui sont en train d'être balayées par cette frénésie industrielle que symbolise l'Exposition universelle de Paris. Il semble plutôt nous suggérer de ne pas saisir la proie pour l'ombre.

Libellules, Joël Egloff, Libellules, « Folio », 160 p., 5,60 euro.
Parfois, il nous vient de nous demander, entre amis, ce que les éditions Gallimard ont en tête quand elles décident d'élire tel ou tel auteur français. Le cas du prolifique Joël Egloff est caractéristique. Ces Libellules sont d'une médiocrité assez flagrante. C'est bien fabriqué, c'est la moindre imagination, en faisant alterner récits courts et récits plus longs, avec une esthétique du quotidien où tout un chacun devrait se reconnaître. Mais voilà, nous, qui en parlons, nous ne nous reconnaissons pas. Nous n'y voyons que de vulgaires chromos sans relief et des anecdotes dignes d'un cinéma d'un réalisme sans profondeur. Depuis quelques années, Gallimard a fait le choix de tourner le dos à son histoire littéraire (mais pas pour les essais, ni pour la littérature étrangère, fort heureusement) au profit d'une littérature de consommation courante. Voici ici l'exemple le plus criant. Mais qui a envie de lire ce qu'il a sous les yeux tous les jours et qui, dans ces pages ne lui évoque que ce déjà vu sans saveur ni promesses ?
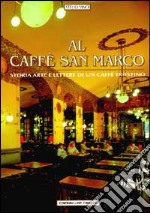
Caffè San Marco, Stelio Vinci, Cominicante Edizioni, Trieste, 152 p., 24 euro.
Pour ceux d'entre vous qui lisent l'italien, je ne saurais trop recommandé la réédition d'un très beau livre dont l'architecte est Stelio Vinci. Il s'agit de la réédition d'un livre paru chez un autre éditeur il y a quelques deux décennies. Le livre a été largement revu et augmenté, autant pour les textes que pour l'iconographie. Pour ceux qui ne connaissent pas Trieste, le Caffè San Marco a été créé dans ce grand port de l'Adriatique en 1914, à une époque où il était encore en Autriche-Hongrie. Son histoire est extraordinairement riche car elle a épousé celle de la grande littérature apparue en cette cité. Elena et Stelio Vinci en font l'historique et des auteurs célèbres ont raconté des fragments, comme Fulvio Tomizza, Giorgio Voghera, Giorgio Presburger et Claudio Magris. D'autres encore ont apporté leur contribution et nous font découvrir ce lieu qui a failli fermer l'an dernier. On aurait perdu les décors et les médaillions de l'étranges Vito Timmel, né à Vienne en 1886 et mort à l'asile de Trieste en 1958, dont Magris parle dans sa pièce de théâtre, l'Exposition. En plus du décor et du mobilier, il ne faut pas oublier l'ineffable atmosphère de ce café, qui semble receler toute la mélancolie de ces rues aux pieds du Karst. Et une légende circule, disant qu'un passage secret relie la salle à la vaste synagogue qui se trouve juste derrière... La légende n'a pas de fondement, mais elle ne cesse d'élever le vieux Caffè San Marco au rang de centre névralgique de la culture triestine.

Le Sang du ciel, Piotr Rawicz, « L'imaginaire », Gallimard, 348 p., 9,50 euro.
Désirez-vous lire un grand livre, j'oserais même dire un petit chef-d'oeuvre ? Alors allez chez votre libraire acheter le Sang du ciel. Le nom de Piotr Rawicz ne vous dit rien ? A moi non plus, je dois l'avouer, à l'instant où j'ai reçu cet ouvrage voici peu. Ecrit en français, il avait paru chez Gallimard en 1961 et c'est le seul texte que nous connaissons de lui. Il n'a pas eu alors le succès qu'il aurait mérité. Et pourtant... Il y a transposé son expérience à Auschwitz, où il avait été envoyé, non en tant que Juif (il avait eu un certificat médical expliquant que sa circoncision n'avait pas eu lieu dans des circonstances liturgiques !), mais comme prisonnier politique. Auschwitz se métamorphose dans cette magnifique fiction en une cité utopique, où la réalité et l'imaginaire se fondent en une seule et même entité. Les lois de la raison et de la justice y sont abolies. C'est un univers paradoxal entre 1984 et les Enfers des peintures de Jérôme Bosch, entre Kafka et Campanella. Un monde idéal de l'horreur et de la mort, un meilleur des mondes, surréaliste et halluciné, que n'aurait pas renié William S. Burroughs. C'est magnifique et effroyable à la fois. Et d'une richesse sans fond car l'écrivain a dépeint mille et un destins individuels dans l'absurdité extrême de cet univers fantomatique. Il est parvenu à insuffler l'esprit d'une beauté dans ces pages pleines d'horreur et de mort. C'est la beauté de l'humanité qui, en dépit de son épouvantable dégradation, parvient à sauver de ce naufrage absolu sa puissance et sa poésie.
|
