
Dans ma bibliothèque, la guerre et la paix, Marc Fumaroli, « Tel », Gallimard, 540 p., 18 euro.
Grand érudit, Marc Fumaroli a produit en 1980 un livre qui pourrait un peu s'apparenter aux Essais de Michel de Montaigne. ll vient d'être réédité cette année. C'est un mélange d'articles parfois brefs, parfois plus développés, sur de grands auteur (comme Tolstoï par exemple, qui revient à plusieurs reprises) ou sur des thèmes, de l'antiquité à une période récente. Les sujets les plus divers se succèdent et ne forment pas un ensemble construit. De l'abbé Du Bos, historien de la monarchie absolue, jusqu'à les théories néoclassiques de Winckelmann à ce que Chateaubriand a perçu dans la révolution américaine, on passe par mille questions et parfois même à des points qui concernent l'art (Rubens, Degas, Vélasquez, Poussin, David) sans omettre d'autres sphères, comme celle de notre histoire de la religion (la condamnation des Maximes des saints).
Il nous invite à effectuer un merveilleux voyage dans notre culture en fonction de ses lectures et de ses curiosités qui, ici, dépassent de loin le Grand Siècle. On découvre le retour de la querelle des anciens et des modernes en 1714 ou ses considérations sur L'Enéide de Virgile qui sont très judicieuses. C'est là un recueil à compulser de temps à autre au gré des thèmes que l'auteur nous propose. Choisissons au hasard « Description de tableaux et thérapeutique » un essai, « Description de tableaux et thérapeutique » où il superpose les personnages de l'écrivain, François Fénelon, et celui du compagnon de Télémaque, Mentor, cataloguant les oeuvres qui représentent les différents épisodes du roman, de Van Loo à Charles Le Brun. Il fait valoir ce qui dans un roman philosophique a pu tant inspirer les artistes contemporains de sa parution et de son indéniable succès. Marc Fumaroli a eu le don non seulement de nous rendre présent. C'est l'exposition du développement d'un phénomène culturel qui vient bouleverser un certain ordre des choses, ou plutôt le modifier en l'enrichissant. Giambattista Tiepolo est un de ces maîtres qui ont illustré ces aventures dans d'immenses plafonds où il déploie les beautés de l'île de Calypso, comme l'ont fait Watteau, Charles Audran III ou encore Jean Le Pautre, parmi bien d'autres.
La délicieuse reine de Cythère et de ses merveilleuses propriétés sont devenus un sujet à la mode, quasiment incontournable. Marc Fumaroli a eu le don rare d'être en mesure d'évoquer en détail certains épisodes de cette fiction pédagogique tout en évoquant ceux qui, parmi, les peintres ont su le mieux les traduire sur la toile. Ce miracle d'érudition est en même temps un miracle de plaisir de la découverte des temps anciens qui ont été au fondement de notre éducation. Ce fort volume est vraiment un enchantement. A découvrir sans attendre.
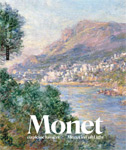
Monet en pleine lumière, sous la direction de Mariane Mathieu, Grimadi Forum / Editions Hazan, 288 p., 39 euro.
Si Monte Carlo possède un célèbre casino et aussi un superbe jardin botanique, elle ne possède pas de musée des beaux-arts ! Cela signifie que les grandes expositions sont rares sur le Rocher ! Peut-être les choses vont-elles changer cette année avec la présentation d'une importante exposition d'oeuvres de Claude Monet (1840-1926) présentée au Grimaldi Forum pendant cet été.Si ce n'est pas une rétrospective au sens habituel, l'exposition nous fait comprendre l'évolution de son idée de la peinture. On y voit quelques toiles des années 1860, quand il se rendait avec Eugène Boudin à Sainte-Adresse ou à Rouelles ou ailleurs sur la côte normande sur l'Atlantique. D'autres peintres sont attirés par la mer de cette région comme Daubigny ou Jongkind. Comme Monet, qui déjà lorsqu'il étudiait auprès de Charles Gleyre à l'École des beaux-arts de Paris, était opposé à l'enseignement classique. Son réalisme semblait exagéré.
Peu de temps après, il prend la liberté de quiche avec le spectacle de la nature. La lumière compte beaucoup pour lui et il s'efforce de rendre le ciel très clair. Au début des années 60, il ne se démarque pas beaucoup de ses amis. Ses plages sont proches de celles de Boudin. Mais, étrangement, tout change au cours des années 70. La nature est traitée avec plus de liberté et les figures humaines sont comme des croquis rapides. Les paysages sont ses sujets de prédilection. Durant cette période, il privilégie la rive des fleuves et peint aussi des villages ou des champs sous la neige, le blanc créant un presque monochrome.
Mais ce n'est pas tout : les formes sont de moins en moins définies. Vitueil dans le brouillard (1879) est une vue large où l'on ne sait pas où les bords de l'eau se terminent au premier plan et où commencent les collines blanches. Le ciel se confond un peu avec la nature. Ce n'est pas encore son choix esthétique mais c'est l'annonce d'un nouveau départ. S'ensuit une période de transition où il y a une partie de l'image soigneusement dessinée et d'autres, plus libres.
L'évolution picturale de Monet n'est pas linéaire : il connaît des allées et venues constantes. Deux toiles peintes en 1883, Monte Carlo vues de Roquebrune montrent qu'il pouvait traiter le même sujet de différentes manières, la première plus réaliste, la seconde avec une sorte de brume qui efface le paysage au profit de la couleur. Il n'y a pas de système de Monet : son inspiration a la faculté de procéder de différentes manières : il choisit d'utiliser pour sa nouvelle peinture une sorte de réalisme ou non. Il est toujours à la recherche d'autres façons de rendre ce qu'il voit, en changeant les effets de la lumière, la façon dont il utilise la couleur, le traitement du ciel, etc. Durant les années 90, il accentue le pouvoir de la lumière et ici il peut faire disparaître une partie d'un paysage comme dans La Seine à Port-Villez (1894) ou dans la Pointe du Petit Ailly (1897).
Et puis il a osé définir des champs visuels étranges comme dans le Massif de chrysanthème (1897). Ce n'est pas une nouveauté dans sa production mais cette fois il semblait vouloir aller plus loin. Les Nymphéas, au début du XXe siècle marquent une rupture, car la comparaison avec le plan d'eau et les plantes flottant au-dessus donne naissance à un nouveau monde. Ses couleurs deviennent plus irréelles et la composition semble perdre sa relation avec la vérité de ce que nous voyons. La peinture devient à ce stade une pure invention. On peut le voir avec son Pont Japonais. Plus tard, il s'est impliqué dans une sorte d'abstraction aux teintes violentes. Ce pont, par exemple, est presque méconnaissable. Et il aimait aussi s'assurer qu'une couleur couvrait presque tout le champ de vision. La Maison de l'artiste (1922-1924) est un exemple de son dernier défi. L'exposition a révélé également des photographies anciennes de la Côte d'Azur à l'époque de Monet. C'est très intéressant car ces rives de la Méditerranée ont beaucoup changé ! Il existe également des documents sur Bordighera où l'artiste s'est rendu au début des années 80. C'est l'occasion de découvrir des peintures peu connues réalisées dans ce lieu. Bref, nous ne connaissons pas encore assez bien Claude Monet aussi bien que nous le croyons. Cette exposition a révélé de nombreux autres aspects de son exigeante recherche picturale. A ne manquer à aucun prix.

Facéties, Eric Rondepierre, « Récit », Tinbad, 100 p., 17 euro.
Eric Rondepierre, en plus du fait qu'il est un artiste passionnant, est un auteur qui passe sans difficulté de la pure fiction à l'essai. Et il lui arrive aussi de mêler les deux genres. C'est en tout cas ce qu'il a voulu faire dans Facéties. Il y relate de brides de son existence à différents moments de son histoire personnelle et aussi ce qui a pu l'animer et lui suggérer des idées et surtout le désir de mettre en forme des considérations qui lui sont venues à l'esprit. L'imbrication de ses faits et gestes et de ses cogitations n'a pas engendré un livre hybride, mais plutôt un récit un peu décousu qui ne se réfère à aucun mode connu. Sa narration est parfois déroutante, mais n'est jamais hasardeuse. Il est indéniable qu'il s'est plu à égarer le lecteur dans ce labyrinthe qui est la traduction de sa manière de penser et de ses comporter.
Il nous fait surtout état de sa relation complexe avec l'image photographique, qui le fascine, le trouble et lui inspire des méditations qui s'éloignent de la manière commune de considérer l'enregistrement du réel ou d'une composition de quelque ordre que ce soit. Il veut que ce qu'il capture soit non le reflet de sa vision, mais la création d'une vision intérieure qu'il eut saisir dans le monde tangible. C'est forcément déroutant, mais c'est d'abord la clef de ce qu'il poursuit dans son oeuvre plastique, qui est nécessairement un piège pour l'oeil du spectateur. Le titre de cet ouvrage n'est pas tout à fait innocent et est à double sens : c'est à la fois une dérision de notre façon de considérer la littérature par les temps qui courent et aussi une exploration de la dérision et de l'auto-dérision qui passe surtout par la grimace ou la déformation des traits du visage ou même de la position du corps. La dernière partie du livre est d'ailleurs consacrée surtout aux Têtes de caractère de Franz Xaver Messerschmidt, aux Grimaces de Louis-Léopold Bailly. Dans ces pages, l'auteur est une sorte de narrateur un peu fantomatique (mais toujours fantasque et blagueur) qui semble être sur une scène théâtrale, étant le centre de l'attention d'une foule pas forcément avenante.
Cela fait penser aux menées de Josef K. Dans Le Procès de Franz Kafka. Mais ce n'est pas la conscience d'une faute qui le hante, mais tout simplement le regard d'autrui. Il se donne à voir avec des expressions faciales monstrueuses et grotesques. C'est sans doute une métaphore du rôle de l'écrivain moderne ! Celui-ci a perdu le lien profond avec ses lecteurs et ne peut attirer leur attention que par de formidables pitreries. Cet ouvrage est très intense et devrait être pour nous une source de méditation poussée sur le jeu esthétique et ce que l'artiste (ou l'auteur) transmet désormais à autrui. C'est en tout cas un livre tout à fait remarquable.

Pour personne, Cédric, Demangeot, lecture d'Alexandre Battaglia, dessin d'Ena Lindenbaur, L'Atelier contemporain, 166 p., 20 euro.
Ce livre a déjà été publié il y a vingt ans. L'auteur est étonné de se relire ! Il faut dire que son écriture est loin d'être conformiste. Et l'histoire ne prend pas son essor, étant souvent reprise avec un nouveau commencement. Tout débute avec un chien, puis avec un rat et le narrateur ne trouve pas la solution pour mettre en bon ordre son histoire. Il ne cesse de la recommence en s'interrogeant sur mille aspects de l'écriture, passant de la langue des linguistes à celle des inconscients. C'est lui qui l'affirme. L'auteur s'interroge sur sa faculté de produire un texte digne de ce nom et le narrateur s'interroge lui aussi. On comprend bientôt que l'écrivain est hanté par l'idée d'arriver quelque part, mais où ? Et le narrateur se demande si le chien va revenir...
Petit à petit, l'auteur s'interroge sur tout ce qui constitue son univers quotidien et puis son univers imaginaire, qui se dérobe le plus souvent. Il invente une sorte de personnage qu'il baptise « Jean Personne ». Il lui invente une serre où il soigne ses plantes et va méditer. Et puis il y les rats qui se faufilent sous le plancher. En somme, cette paix est une illusion. D'autres personnages apparaissent, comme Monsieur Mô. Et aussi Pierre Debout, un lettré. Mais là notre malheureux héros n'a pas d'amis... Il est aux prises avec les lacunes, qui l'oblige à recommencer et recommencer encore. A un certain point, l'auteur met en doute le statu de jean personne, qui n'est pas vraiment un écrivain. Est-ce la réalité ? Le carnet de ce dernier révèle un poème. Et aussi des notes quotidiennes. Il y fait part de toutes ses inquiétudes, pour ne pas dire de ses angoisses. Il y parle de sa relation à son univers livresque et de ce que les livres lui inspirent. Il consigne ses états d'âme dans ses carnets et évoque aussi sa rencontre avec Mirellea. Cette dernière prend une place considérable dans on existence, mais ne lui fait pas oublier ses peurs. Et de nouveau il est pris par le désir de débuter quelque chose... C'est un ouvrage des plus singuliers, qui est intriguant. Je ne sais pas s'il est plaisant ou non. Je sais seulement qu'il sort de l'ordinaire Les commentaires d'Alexandre Battaglia en postface sont judicieux et éclairants...

Le Dialogue, Simon Johannin, Allia, 80 p., 7 euro.
Ces pages me laissent un peu perplexe. Ces méditations et cette conversation avec la mort ne me donne pas le sentiment d'une plongée vertigineuse de la pensée. J'ai plutôt l'idée que l'auteur a abusé d'une forme philosophique pour donner une sorte de gravité et de profondeur à ses propos. Bien sûr, il y a des images fortes dans ces pages et quelques réflexions qui sont saisissantes. Mais il manque ce je ne ce je ne sais quoi de vibrant et de prenant pour que le lecteur que je suis se laisse prendre au jeu. Cela donne le sentiment d'être une sorte de pastiche d'un texte philosophique ancien.
L'auteur s'est pris un peu trop au sérieux et n'a pas su donner à ses écrits cette distance nécessaire pour les rendre originaux et singuliers. On me trouvera sans doute sévère, mais je ne suis pas parvenu à entrer dans le jeu de l'auteur. Peut-être n'ai-je pas la tournure d'esprit juste pour ce faire. La forme contribue à rendre ces conversations plaisantes et attirantes. Et puis Simon Johannin a des expressions malheureuses par exemple : « j'étais noyé dans la peur ». Je suis étonné car les Editions Allia nous ont habitué à des publications plus pertinentes. Mais la littérature requiert un peu plus d'invention et de richesse. Mais ce n'est ici qu'un mauvais choix, et aucun éditeur ne peut être à l'abri d'un faux pas.

Qu'est-ce que lire ? José Ortega y Gasset, traduit de l'espagnol par Mikaël Gòmez Guthard, Editions Allia, 48 p., 6, 50 euro.
La question peut paraître surprenante, mais elle est fondamentale. Et nous serions bien en mal d'y répondre de but en blanc. Cet essai d'e José Ortega y Gasset (1883-1955), a paru en 1946. Ché es leer est une réflexion sur une pratique qui nous semble familière et qui ne nous pose pas de problème. A ses yeux, et c'est par là qu'il commence, c'est une activité utopique. Son exercice est de nature approximative et implique des contradictions. L'idée de base serait l'entendement de l'ensemble du texte. Mais est-ce possible ?
La compréhension complète d'un texte, qui est impossible. Cela suppose des connaissances et des pratiques très diverses. Il est donc convaincu qu'il ne s'agit en réalité d'une interprétation. Il faut déjà se placer dans la perspective de sa conception. Cela entraîne l'auteur à diverses considérations sur le langage et sur la linguistique moderne. Il développe toutes sortes de considérations(passionnantes) sur la langue, son expression, sur le son, le geste, la grammaire, le contexte, etc. La lecture exige aussi une somme de savoir important pour lire un ouvrage - il prend ici pour exemple Le Banquet de Platon. Faute de l'auteur, nous avons la possibilité de pénétrer une pensée écrite, avec sans doute des impondérables...

Incident à Vichy, Arthur Miller, traduit de l'anglais (Etats-Unis) et adapté par Maurice Kurtz, « Pavillon pôche », Robert Laffont, 144 p., 8 euro.
Le Miroir, Arthur Miller, traduit de l'anglais (Etats-Unis) et adapté par Michael Fagadau, « Pavillon pôche », Robert Laffont, 192 p., 8 euro.
Dans Incident at Vichy, nous découvrons des hommes d'origines sociales diverses se retrouver dans un camp d'internement. Nous sommes en 1942 dans la Zone libre de la France, celle du gouvernement de Vichy. Ils sont gardés par des miliciens. Tous ces hommes de tous âges et de toutes conditions. Il y a un vieux Juif barbu et un bohémien au milieu de personnes telles qu'un major de l'armée, un professeur, un garçon de café, etc.). Ils ne cessent de s'interroger sur leur présence dans ce lieu où ont lieu des interrogatoires. De vagues allusions aux camps comme Auschwitz et aux fours crématoires se glissent dans leur conversation. Mais tout demeure dans le vague.
A la fin, le prince von Berg fait évader l'un de ces individus et le charge de porter une bague à la mère d'un des détenus... Arthur Miller a écrit une pièce qui est une virulente attaque contre le gouvernement du maréchal Pétain. Cette pièce a été représentée en France au début des années soixante-dix, Sacha Pitoëff tenant le rôle du prince. Elle a été publiée en français pour la première fois par la revue L'Avant-scène en 1972.
Broken Glass est une pièce que l'auteur a terminée en 1994. Elle débute par la rencontre d'un certain Philip Gellburg (un Juif originaire de Pologne) avec le docteur Harry Hyman : il s'inquiète beaucoup pour sa femme, Sylvia, qui ne parvient plus à se lever. Le médecin avance quelques hypothèses et cherche à comprendre en interrogeant le mari. Le lendemain, Sylvia lit dans le journal qu'en Allemagne, les nazis brisent les vitrines des magasins juifs. Cette nouvelle la trouble profondément. Le docteur s'intéresse au cas de cette jeune femme et il interroge sur mari. Il lui recommande de lui prouver charnellement son affection. Celui-ci s'exécute, mais son épouse prétend ne se souvenir de rien le lendemain. Le thérapeute ne sait plus comment aborder la question, d'un simple point de vue clinique ou dans une optique psychanalytique.
Quant à Gellburg, il se retrouve dans un état de trouble, qui, en fin de compte, semble être la conscience malheureuse de sa judéité. Il est conscient de sa différence dans toutes les situations que se présentent à lui dans son existence personnelle ou professionnelle. Etre juif est une sorte de malédiction incessante. Dans cette pièce étrange, Arthur Miller a voulu mettre en scène ce qui fait la spécificité de l'être juif même si l'on est parfaitement intégré dans la société de son temps et s'il ne déroge en rien aux coutumes en vigueur dans le pays où il vit.
Ces deux pièces tranchent sur le reste de sa production car elles font référence à la douloureuse question juive. Arthur Miller qui a des antécédents juifs n'évoque pas ses origines en règle générale. Incident à Vichy est une oeuvre très singulière car à l'époque le gouvernement américains a continué à entretenir de bonnes relations avec le gouvernement de Vichy.
|
