
Henri Matisse, le laboratoire intérieur, sous la direction d'Isabelle Monot-Fontaine & de Sylvie Ramon, musée des Beaux-arts de Lyon / Hazan, 360 p., 44,95 euro.
Combien je regrette de ne pas avoir pu voir cette exposition à Lyon ! Mais le merveilleux catalogue nous montre quelques 250 reproductions et des essais tout à fait intéressants. Ce qui frappe dans sa relation avec Picasso, son grand ami et grand rival, c'est une certaine parenté dans l'attitude : Henri Matisse a, comme lui, passé, d'une néoclassicisme réinterprété aux innovations les plus tapageuses. Quelques tableaux nous montrent sa faculté de métamorphoser une composition picturale en quelque chose de renversant, comme, par exemple, Le Divan. En réalité, ce qui les distingue, au-delà du style, des options théoriques, de tout ce qui le rend unique, c'est le choix délibéré de Matisse de jouer la carte du décoratif. Sans doute son goût de l'arabesque, des tapis, des rideaux, de tout ce qui compose un ameublement plus ou moins imaginaire, mais toujours en relation avec la réalité, a été prédominant chez lui. Mais cela va bien plus loin : même si son oeuvre est conçue selon des critères amplement radicaux et loin des lois de la composition d'autrefois, il en corrige la virulence par ce penchant pour les arts décoratifs qu'il n'abandonne jamais et, même, au contraire, qu'il accentue encore à la fin de sa vie avec les papiers découpés. Ce n'est pas un subterfuge, mais une esthétique. Ce qui peut paraître choquant chez Picasso, est atténué par ces effets harmoniques et délicieux. Le « fauve » donne l'impression de rentrer ses griffes, alors qu'il peut très bien aller assez loin dans une nouvelle forme d'expression plastique, comme c'est le cas dans La Jeune femme à la pelisse blanche (1944). Matisse demeure hanté par une idée de la beauté qui est apollinienne. Pour Picasso, il risque la laideur (par rapport à son temps). On peut découvrir au fil des pages de nombreux visages (des merveilles d' »abstraction »), des portraits (dont ceux de Louis Aragon), des nus, des natures mortes. On ne le voit pas passer (de manière plus criante avec le crayon noir sur une feuille blanche) de l'ingrisme (comme l'a fait Picasso et même Marcel Duchamp !) à des formes dénaturées. Il y manifeste la même pureté dans l'écriture, ce qui est une gageure. Ce catalogue est précieux, car on comprend que Matisse n'a pas de principes catégoriques, ni même de ligne spéculative définie pour une série, exception faite des suites dessinées dans la même foulée. Il passe de l'un à l'autre avec une incroyable désinvolture et avec une sûreté dans la démarche absolument semblable. Boulimique dans le travail (comme Picasso, encore une fois), il ne se donne donc pas de limites. Le catalogue montre que peu d'exemples de ses ouvrages où le décoratif se trouve en première ligne (les commissaires ont choisi de montrer quelques pièces révélant ce penchant, qui est loin d'être négligeable ou secondaire). C'est une manière de le découvrir sous un éclairage sensiblement différent. Et c'est aussi le moyen de découvrir des crayons ou des encres de Chine qu'on n'avait guère eu l'occasion de voir. C'est un ouvrage précieux pour le néophyte comme pour le connaisseur.

Edmé Bouchardon, une idée du beau, sous la direction de Guilhem Sherf & de Juliette Trey, musée du Louvre éditions / Somogy, 448 p., 49 euro.
La sculpture du XVIIIe siècle n'est connue que des spécialistes et des amateurs et même le nom d'Antonio Canova, chef de file du néoclassicisme, ne dit quelque chose qu' à un petit nombre. Bouchardon n'a pas laissé une grande empreinte dans les esprits cultivés, pas plus que Pigalle ! Et pourtant, Edmé Bouchardon, (1698-1762), né dans une famille de sculpteurs et d'architectes, s'est fait vite remarquer pour ses dons à l'Académie et il remporte le prix de Rome. Il séjourne neuf ans dans la cité éternelle et y exécute même un projet pour la fontaine de Trevi. Il est admis à l'Accademia di San Luca. Plusieurs de ses grandes réalisations peuvent encore se voir à Paris, comme la fontaine des Quatre Saisons rue de Grenelle, les sculptures du choeur de l'église Saint-Sulpice et d'autres qui ont disparu comme la fameuse statue équestre de Louis XV qui a été détruite (elle avait été placée place de la Concorde qui s'appelait alors place Louis XV). Son oeuvre est importante et donne bien le ton de la sculpture néoclassique dans notre pays. Il a été un dessinateur magnifique et il n'a pas rechigné à faire des ouvrages comme les Cris de Paris, qui montrent les petits métiers de la capitale à l'époque (en plus de l'ensemble des gravure, on peut en admirer les sanguines dont elles ont été tirées). Bien sûr, il est plus connu pour son buste du pape Clément XII ou pour celui de Charles-Frédéric de la Tour du Pin. Mais il aimait tous les sujets, des plus conformistes, comme les scènes mythologiques (comme le Faune endormi conservé au Louvre) ou l'Amour se faisant un arc de la masse d'Hercule. Dans le registre religieux, sa Vierge de la douleur, dans l'église Saint-Sulpice, est d'une beauté et d' une harmonie, fruits d'une grande retenue expressive et pourtant d'une force évocatrice très puissante, qui contraste avec les exemples quasiment uniques de la statuaire baroque en France qu'on trouve en ce lieu. Ce qui frappe le plus dans cette exposition et dans son catalogue, c'est le petit nombre d'oeuvres réalisées par rapport au nombre de projets de l'artiste.
Pour mieux connaître la carrière et aussi le contexte culturel de son temps, il faut absolument lire le comte de Caylus (1692-1765), amateur d'antiquités, écrivain et graveur, auteur des Nouveaux sujets de peinture et de sculpture (1755) et d'un livre de biographies d'artistes de son temps, dont celles de Watteau et de Bouchardon). En plus de raconter comment Caylus a perçu la personnalité et l'art de Bouchardon, Marc Fumaroli énumère ce qu'a réalisé Bouchardon et les réactions des amateurs ou des sculpteurs d'alors, nous montre dans quel milieu il évoluait. Il en a enfin défini la grande originalité. Dommage que ses considérations ne soient pas accompagnées du texte écrit par le comte, qui a joué un rôle éminent dans la connaissance de l'Antiquité et écrit des contes érotiques !

Michel-Ange, Hector Olback, Hazan, 96 p., 25 euro.
Cet album pose d'innombrables questions. La bande dessinée a envahi désormais tous les domaines de la culture : cela a commencé par la littérature, et aujourd'hui les arts plastiques sont à leur tour transposés dans cette nouvelle sphère de la galaxie Gutenberg, non sans provoquer un paradoxe, car cette manière de traduire l'histoire ne peut se faire autrement que par l'image ! Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une traduction par le dessin de la vie et de l'oeuvre du grand artiste florentin. Il s'agit plutôt d'un découpage de photographies d'oeuvres célèbres, comme sa Pietà et la chapelle Sixtine. Chaque image fait presque chaque fois l'objet d'un commentaire. Ces commentaires sont très courts et ont manifestement une fonction didactique : par exemple, en ce qui concerne la Pietà, on nous montre sur toute une page plusieurs parties de l'oeuvre avec ce genre de légende : « chaque détail donne envie d'être regardé de plus près... » Les épisodes de la Création peints dans la chapelle Sixtine sont expliqués de manière succincte. Alors que penser vraiment de cette tentative de rendre plus accessible ces chefs-d'oeuvre ? Personnellement, je doute assez fort de sa valeur pédagogique, car rien n'est finalement expliqué et surtout rendu de manière convaincante, ne serait-ce que par l'extrême brièveté des textes. D'autre part, rien n'est dit de la pensée sur l'art de l'artiste, de sa poésie, de sa position esthétique par rapports aux autres créateurs de son temps. Bien sûr, ce mode d'exposition est divertissant et se révèle d'un accès très facile. Bien difficile donc de parvenir à une conclusion : seule une classe de gamins pourrait peut-être, par les réactions et les réflexions des uns et des autres, donner une idée de l'efficacité du livre. Ce n'est pas quelqu'un comme moi qui, immergé jusqu'au cou dans les arts, pourrait en mesurer l'efficacité. Alors je laisse libre le lecteur de le feuilleter et de se faire sa propre opinion sur la question.

Musique et transe chez les Arabes, Gilbert Rouget, Allia, 128 p., 10 euro.
Qui connaît un peu le monde arabe sait que la musique peut être en certains cas extrêmement prisée et d'autres fois, condamnée avec sévérité. Cela peut nous sembler étrange et ce l'est d'ailleurs sans conteste. Ce livre permet de comprendre les relations intenses et paradoxales qui se sont nouées entre la civilisation musulmane et l'art musical à travers la religion. Très vite, les disciples de Mahomet, plutôt que de se soumettre aux seuls préceptes du Coran, ont cherché une relation directe avec Dieu. Celle-ci ne pouvait être obtenue que par une expérience enivrante. Et cette ivresse nécessaire pour atteindre ce but mystique, les dévots l'ont trouvée dans la danse, la musique et parfois la psalmodie. Cela s'est manifesté par la naissance de la secte des soufis. Ces hommes ont vécu en marge de la société de leur temps, par choix, mais aussi parce qu'on se méfiait d'eux. Souvent, ils ne pouvaient pas demeurer dans la ville la nuit et ils campaient sous les remparts. Leurs rites étaient trop étranges pour les bons musulmans et encore plus pour les hommes de la loi. Ils se servaient de la musique pour entrer dans un état second qui les rapprocherait du divin, et la musique était l'élément majeur pour y accéder. Ils ont très vite adopté le café, qu'ils utilisaient pendant leurs cérémonies, ce qui les rendit encore plus suspects, car cette boisson a mis du temps à s'imposer à tous. On la considérait comme une substance stupéfiante, comme l'alcool ou le kif. Ces fous de Dieu ont pourtant peu à peu élaboré des formes très élaborées pour accomplir ces danses et ces transports. Ghazzalî a écrit un important ouvrage à ce sujet, le Livre des bons usages de l'audition et de la transe au début du XIIe siècle, qui prouve que tout était très bien codifié. Par exemple, le support musical se résumait à un tambour et à une flûte, seuls employés en général pour le samâ. Il est clair que la seule lecture du Coran ne peut suffire pour atteindre l'extase (wadj). Il fallait avoir recours à la danse et à la musique. L'auteur décrit très bien, et en détail, toutes les nuances de ces expériences transcendantales qui aboutissent à une perte des sens. Et il en dresse une typologie exhaustive. Cette étude est indispensable pour comprendre la mystique musulmane. Elle s'es traduite par la suite par les pratiques des derviches tourneurs et des derviches hurleurs (terme un peu erroné, précise-t-il, car il ne s'agit pas de cris, mais de psalmodie). Cet ouvrage doit donc trouver sa juste place dans une bibliothèque digne de ce nom.

Georges Pérec, cahier dirigé par Claude Burgelin, Maryline Heck & Christelle Reggiani, L'Herne, 280 p., 29 euro.
Georges Pérec (1936-1982), a connu la reconnaissance du monde littéraire dès son premier roman, les Choses en 1965, qui lui vaut de recevoir le prix Renaudot. Il est vrai que ce livre a marqué une rupture radicale, peut-être même plus radicale que celle du Nouveau Roman : il n'y a pas de personnages dans ce livre, mais des objets usuels et rien qu'eux. Ce petit Juif polonais né à Paris pendant le Front populaire a mis en branle une révolution littéraire qu'il allait poursuivre quelques années plus tard avec la Vie mode d'emploi, publié en 1978 et qui lui vaut le prestigieux prix Médicis. Il a publié beaucoup d'ouvrages, de caractères différents, d'un intérêt parfois très inégal, son goût pour les jeux oulipiens l'ayant conduit à des créations qui pouvaient être d'excellentes facéties ou une forme de dérision de la chose littéraire par ses littérateurs, mêmes. Mais il y a chez lui une sorte de dispersion qui est sans nul doute la conséquences des livres qui l'avaient rendu aussitôt apprécié de beaucoup. Pour ce qui est de ce Cahier, il déborde de petits textes passionnants (dont un essai sur le cas d'Alain Robbe-Grillet et un autre sur le Nouveau Roman - le plus curieux est celui sur Gustave Flaubert) ou de textes rares de l'écrivain, de lettres adressées à Maurice Nadeau ou à Régis Debray. Comme toujours, il est archicomble de tentatives critiques de toutes sortes et, dans son cas, ce n'est pas un luxe, car Pérec avait le goût de l'expérimentation (sans être toujours un auteur « expérimental »). C'est d'ailleurs assez divertissant de les lire les uns après les autres, car on a parfois l'impression qu'ils discourent tous sur un écrivain différent ! Il est clair que Pérec, par son goût du divertissement, est l'anti Balzac ou l'anti Stendhal : son oeuvre est un mouvement perpétuel qui exige d'incessantes mutations. IL engendre la fiction de l'origines des espèces littéraires, non celles du passé, mais celles de son présent ! Il a voulu nous faire comprendre ce que le roman français devenait après les audaces du Nouveau Roman. Facétieux et figure aux mille visages, Pérec ne fait que se cacher derrière tous les subterfuges dont il a été capable. Il s'est inventé d'ailleurs une allure correspondante à ce projet à la fois charmant et dérangeant. Toutes ces études nous révèlent ces facettes innombrables et nous permettent de découvrir cette oeuvre importante en nombre, importante pour ses implication, mais souvent très inégale. Certains de ses livres sont vraiment dépourvus d'intérêt, comme, par exemple, la Tentative de description d'un lieu parisien. C'est le prix à payer quand on a choisi une telle démarche ! Mais cela ne veut pas dire un instant que Georges Pérec soit un auteur mineur ou raté. Non, il a parfois dérapé, mais il y a assez de bons livres pour le sauver des eaux, comme Boudu !

La Seule exactitude, Alain Finkielkraut, édition augmentée, Folio, 336 p., 7,70 euro.
Alain Finkielkraut a fait partie de ces intellectuels français qui ont choisi de jour le jeu de la transmission médiatique. On l'a beaucoup entendu à la radio et beaucoup vu à la télévision. Puis il est entré à l'Académie française (pourquoi, Dieu du ciel ?) et il a disparu des écrans et sa voix s'est moins entendue dans les micros de France Culture. Son intelligence, personne ne peut la mettre en doute. Je me souviens de commentaires de la Torah qui étaient très brillants et révélateurs. Mais de sa sagesse et de sa cohérence, là, on peut avoir quelques doutes. A force de se dispenser de droite et de gauche, statuant sur tous événements nationaux et internationaux, de société et les jugements sur le tout et sur le rien, sur la politique, il me semble qu'il s'est un peu perdu dans un labyrinthe bavard. Il tient de beaux discours, s'exprime très bien,, il sait se faire convaincant, Cet ouvrage commence sur un article concernant la loi Taubira Sujet non négligeable d'ailleurs, suivi d'un autre sur la question du mariage pour tous et puis il en vient à parler de la boulimie de culture des Juifs de Theresienstadt et puis de cinéma. Il évoque la « démission » de Benoît XVI et puis la mort de l'écrivain Stéphane Hessel. Ce dernier avait déclaré que l'occupation allemande n'était rien devant l'occupation israélienne de la Palestine. Là on pénètre dans son jardin secret. Il dénonce l'antisémitisme islamique (ce qui est une grave erreur, car il s'agit d'une petite fraction de musulmans en France) et condamne les agissements du gouvernement d'Israël (indéfendables, il est vrai) sans jamais exposer le fond de sa pensée. Tout est dit en vol plané, sans jamais entrer dans le coeur du sujet. Il papillonne en donnant un petit coup sur les doigts des Arabes, un petit coup sur la tête des Juifs, s'en prend à la gauche, sans trop forcer le trait, critique un peu tout et ne prend jamais un sujet à bras le corps. L'intelligence se dissout dans l'acide du bavardage. Ce commentaire « à chaud « de l'actualité est sans doute le talon d'Achille du journalisme moderne, mais c'est aussi le gouffre où certaines intelligence sont englouties pour tomber dans le cercle des vaniteux de l'Enfer de Dante.

Attachement féroce, Vivian Gornik , traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Læticia Devaux, Payot, 226 p., 20 euro.
Voici une autobiographie qui est rédigée comme un roman. L'auteur ne s'en teint pas à une ligne chronologique continue. Elle revient en arrière dans le temps, mais elle boucle toutefois une boucle puisqu'on part de sa tendre enfance pour terminer au moment où sa mère arrive à ses quatre-vingts ans. C'est donc un livre conçu à la fois comme un roman et des mémoires. Et c'est là une grande partie de son charme. De plus, elle raconte pour une part la vie de son immeuble, les personnes qui y vivent, surtout des Juifs et des Russes, et aussi la vie dans son quartier cosmopolite de New York, le Bronx. Le titre en français est peut-être excessif, mais il s'agit surtout de la relation exclusive, faite bien sûr d'amour mais aussi de beaucoup de conflits et de non-dits entre la mère et la fille, cette dernière étant la narratrice de ce livre. Ce qui est merveilleux dans ces pages, c'est qu'elles sont justement construites dans un registre romanesque, mais sans pathos, sans effusions, sans) conflits violents exaspérés par une écriture aigre. Seule la mort du père semble le moment où tout semble basculer pour la mère surtout, mais aussi pour la fille. Même s'il y a un frère aîné, la narratrice se retrouve à partager ses jeunes années en conversation avec sa mère inconsolable. L'université (Berkeley), ses premières relations un peu sérieuses avec des garçons, son mariage (qui est un échec cuisant) vont lui permettre d'échapper de sa posture de satellite de cette femme avec laquelle elle est très complice, mais souvent en désaccord. « Attachement féroce » a été écrit avec beaucoup de simplicité, avec un mélange de réalisme pour dépeindre la société de ce quartier peu reluisant, mais qui a aussi un certain charme pour elle, et de pensées sur ce lien complexe entre les deux femmes. Mais Vivian Gornik ne donne pas de leçons, ne fait pas de psychanalyse sauvage, ne transforme pas son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte à la découverte du sexe et de l'amour (avec toutes ses désillusions) en une sorte d'épopée intérieure. Elle prend ses distances avec elle-même, sans pour autant retrancher émotions et sentiments. C'est élaboré avec l'idée de rester simple alors que tout se révèle assez délicat et parfois difficile. Cela se lit avec passion, d'une traite et l'on reste séduit par ce récit qui nous fait partager ces moments intimes sans jamais entrer dans des méandres scabreux ou trop intimes. L'intimité est pourtant le grand thème (et le grand problème) qu'elle dépeint et dont elle montre les facettes heureuses et douloureuses.
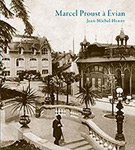
Marcel Proust à Evian, Jean-Michel Henny, Chaman édition, 120 p.
Ce n'est pas seulement un essai biographique sur les brefs séjours à l'Hôtel des bains d'Evian, dont le premier remonte en 1899. Sans doute l'arrière-plan familial est éclairé avec discernement, les relations qu'il a pu s'y faire comptent beaucoup, pour le cours de son existence, bien sûr, mais surtout pour son projet littéraire, car c'est dans cet établissement qu'il rédige les dernières pages d'un roman laissé inachevé, Jean Santeuil. IL y a d'ailleurs la reproduction d'un chapitre très passionnant sur la nécessité de cette fiction. Pour nous, qui avons une vision rétrospective, il est évidemment que ces pages sont la répétition d'A la recherche du temps perdu. Il faut souligner que cet ouvrage a été fait avec grand soin, l'auteur se limitant à ce qui est strictement essentiel, les documents photographiques choisis avec discernement, De plus, l'éditeur a effectué une très belle présentation, ce qui donne un livre d'une qualité peu commune. On découvre avec étonnement le personnage de Proust au mitant de sa vie, assez peu dandy, même assez mal fagoté, avec son chapeau enfoncé de guingois sur la tête, mais en contemplation devant les belles femmes habillées avec art comme Eugénie Bartoloni ou la comtesse Anna de Noailles, la très belle et intéressante poétesse. Les extraits de Jean Santeuil nous éclairent à la fois sur la manière dont il a envisagé ce travail d'écriture et sur ce qui a pu l'inspirer au bord du Lac Léman.

La Peau, l'écorce, Alexandre Civico, Rivages, 112 p., 16 euro.
C'est la guerre qui est au centre du récit. Mais une guerre restituée de manière tout à la fois onirique et symbolique. Nous suivons les faits et gestes d'un homme qui fait partie d'une patrouille dans une zone hors du temps, sous un climat très ingrat. Toutes les expectatives de ces quatre soldats tournent autour d'une source dont les ennemis sont parvenus à s'emparer. Ce n'est pas le Rivage des Scythes ni même Un balcon en forêt. C'est une méditation un peu courte sur ce que peut être l'attente et la condition d'être toujours prêt à mener une lutte sans pitié pour atteindre un but ou simplement ne pas se faire tuer. Quant à l'autre versant du roman, il est encore plus étrange, car c'est l'histoire d'un autre homme qui tente d'échapper à un monde dévasté avec sa petite fille de quatre ans à la quelle il demeure lié bien au-delà de l'amour par un cordon ombilical. C'est là aussi une forme de méditation sur un univers menaçant et les valeurs les plus essentielles qu'il remet en cause avec violence. Il y a ici une vision un peu apocalyptique de notre histoire moderne. Mais tout cela est bien trop métaphorique. L'auteur a bien construit ses récits croisés et a ne s'est pas perdu dans toutes sortes de considérations subsidiaires. Toutefois, cette décantation a été poussée trop loin et on ne parvient pas à prêter crédit à ces aventures humaines, car elles ont été placées sur un plan trop irréel. Il manque à ce livre quelque chose qui serait du ressort du conte philosophique, en somme une vision qui aurait d'authentiques protagonistes ayant un passé et aussi une existence présente. On a l'impression que l'auteur nous a narré une histoire virtuelle et fait de la guerre et de ses ravages une sorte de sujet abstrait. Cela dit, Alexandre Civico écrit de manière très vive et elliptique, et ne s'encombre pas d'adjectifs redondants ni de formules faciles. Il y a dans ce roman un ton très personnel. Cela donne de l'espoir pour l'avenir de son travail d'écriture.
|
