
Aventuriers des mers, VIIe-XVIIe siècle, sous la direction de Nala Adoulat, Agnès Carayon & Vincent Givannoni, Mucem / Institut du Monde Arabe / Hazan, 224 p., 29 euro.
Cette publication mérite nos éloges : elle remplit parfaitement la fonction d'un catalogue classique mais peut être consulté comme un livre d'histoire. Elle contient un nombre important de textes, ce qui nous permet de découvrir toutes les facettes de ces relations entre le monde méditerranéen et les Indes, comme on disait autrefois. Et puis l'iconographie est abondante et superbe, avec toutes ces cartes anciennes qui font rêver et qui nous obligent à nous demander comment les navigateurs faisaient alors pour arriver à bon port ! Les trois commissaires de l'exposition ont opté pour mettre en évidence la dimension mythique et imaginaire du voyage maritime, rappelant l'histoire de Jona, celle de Sinbad le marin dans les Mille et une Nuits. Le périple d'Ulysse dans l'Odyssée n'est pas seulement une fiction qui inventerait l'espace culturel grec, mais qui lui donnerait une sorte de vérité concrète, aboutissant plus tard à la naissance à la Grand Grèce. De plus, on apprend que les premières relations commerciales avec le sous-continent indien ont existé au cours du IIe siècle avant notre ère. La montée en puissance de l'empire roman n'a fait que multiplier ces échanges, en particulier à cause de la demande toujours plus grande des aromates. Sous le règne de Marc Aurèle, ces relations sont à leur apogée. Lucien de Samosate (circa 120-circa 180), originaire de Syrie, a raconté en grec l'histoire d'un jeune homme un peu écervelé qui rêvait de se rendre en ces terres lointaines dans un ouvrage intitulé Alexandre ou le faux prophète. Le grand géographe Strabon parle bien du point de départ de ces expéditions vers des mers peu connues. Une fois parvenu en Egypte, il fallait douze à vingt jours pour atteindre le port choisi pour parvenir jusqu'aux côtes de l'Inde. Pour réussir une telle entreprise, il était indispensable d'avoir une bonne connaissance de la géographie de la région du golfe arabique, mais aussi de son climat, cat il n'était pas possible de s'embarquer à n'importe quel moment. Un document écrit d'un Grec d'Egypte appelé le Périple de la mer Erythrée et rédigé entre 40 et 70 de notre ère apporte de précieuses informations sur ce sujet. Mais les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage nous entretiennent de la piraterie, sur la côte swahilie (ce n'est donc pas une affaire des plus récentes !) ou nous parlent de la vie maritime à Byzance, dont on ignore quasiment tout. Et il y est aussi question des produits échangés dans ces régions lointaines. En somme c'est une véritable invitation au voyage, ou plutôt à toutes sortes de manière de voyager, pour le commerce, par esprit de découverte, par l'imagination. Bien sûr, il existait une autre voie royale des grandes entreprises commerciales, celle de la terre (on pense aussitôt à la route de la soie). Cette histoire là est désormais assez bien connue alors que celle des marins téméraires qui ont traversé des océans peu trafiqués et sont arrivés dans des lieux en partie inconnus jusqu'au XVIIe siècle (le siècle où Jan Lemaire découvrit le détroit qui porte son nom en Antarctique) ne l'est pas beaucoup. Cette recherche est passionnante et nous offre, en plus d'une exposition passionnante, un livre qui recèle une foule d'aliments succulents pour nourrir notre curiosité.

Pourquoi je suis sculpteur, Alberto Giacometti, Fondation Giacometti : Hermann, 64 p., 8 euro.
Je fais certainement de la peinture..., Alberto Giacometti, Fondation Giacometti / Hermann, 64 p., 8 euro.
Notes sur les copies, Alberto Giacometti, Fondation Giacometti / Hermann, 64 p., 8 euro.
Le rêve, le sphinx et la mort de T., Alberto Giacometti, Fondation Giacometti / Hermann, 64 p., 8 euro.
A la différence de nombre de ses contemporains eux-mêmes artistes, Giacometti n'a pas été un homme de plume. Mais il a laissé néanmoins des écrits qui sont non seulement intéressants pour comprendre sa démarche, mais aussi de beaux morceaux de littérature. Il faut d'ailleurs regretter qu'il n'ait pu terminer la préface à ce grand livre de lithographies qu'est Paris sans fin, avec ses 150 lithographies réalisées entre 1957 et 1962, car on y découvre un être assez différent de celui qu'on découvre à travers ses sculptures et ses peintures - s'il a dessiné une des tours de Saint-Sulpice, il a aussi laissé une petite voiture Renault ! Cet ensemble a paru aux Edition Verve après sa disparition, avec vingt exemplaires de tête en 1969. Dommage si l'on songe aux textes que nous avons sous les yeux dans ces quatre petits livres. Evidemment, Giacometti avait une manière assez particulière d'envisager ses travaux de sculpteur. Ils se sont présentés à son esprit et les aurait exécutés tels quels. C'est qu'il affirme déjà dans des notes de carnets à l'époque où il était proche du surréalisme. Il y affirme que ce n'est après coup que des images et des souvenirs se présentent à lui. Et dans les quelques lignes qu'il a confié à la revue Minotaure en 1933, il conclue en disant qu'il ne peut rien dire de l'objet sur la petite planche rouge : « je m'identifie avec lui », déclare-t-il. Quand il évoque son ami Henri Laurens, il évoque surtout ce que Laurens lui a apporté (Labyrinthe, 1945). Dans une lettre adressée à Henri Matisse en 1949, il lui explique qu'il était dans l'impossibilité de porter un jugement sir l'oeuvre qu'il venait de terminer. Dans la revue Arts il parle longuement en 1957 de la voiture, et tient surtout à faire la différence entre un objet manufacturé et une oeuvre d'art. Et il ne finit pas de surprendre son lecteur quand il parle en 1960 de La Jambe : il explique qu'il ne peut fois une personne que d'une manière morcelée. Le long entretien avec André Parinaud, paru en 1962 dans Arts, est tout à fait éclairant : on comprend à quel point la démarche de cet artiste est devenu sans cesse plus complexe avec le temps. Dans les fragments recueillis par Gotthard Jedlicka en 1953, il parle surtout des relations avec son père, qui était peintre -, et un peintre très connu. Un texte écrit à Stampa un an plus tôt dévoile ce qui peut le distinguer de manière radicale d'un peintre comme Braque. C'est une sorte de confidence très poétique sur sa démarche, qui s'éloigne beaucoup de celle de ses prédécesseurs. Quand il rencontre Alain Jouffroy, le contact ne s'établit pas. Et cela ne se passe pas mieux avec les autres critiques venus l'interroger. Ses réponses, s'il en avait, n'étaient pas celles qu'ils attendaient. Il ne parlait qu'à lui-même. Pierre Schneider a entrepris une visite du musée du Louvre en sa compagnie. Et Giacometti d'admettre qu'il y a fait de nombreuses copies. Mais cette question précise l'amène à insister sur sa notion de la réalité, qu'on ne parvient jamais à copier : ce n'est qu'un fragment de vision qu'on en retire. Quant au quatrième volume, il rassemble des textes en prose, des textes poétiques et des souvenirs tous liés à sa période surréaliste avant la guerre. Voilà beaucoup de pages pour entrer dans l'univers de Giacometti, mais par les moyens qu'il a choisis et non ceux dont on préférerait entendre parler...

XII Tavole, artisti, racconti, cibo ed altro, Stefano Soddu, photographies de Giacomo Nuzzo, 208 p., 40 euro.
Sculpteur, mais aussi écrivain, Stefano Soddu a eu l'idée d'organiser douze dîners chez douze artistes différents. Ces soirées ont eu lieu à Milan avec des artistes comme Marilena De Maria, Previtali, Nangeroni, Raciti, chez l'auteur lui-même et son épouse Gabriella Brambati, et chez son fils, le dîner étant préparé par Angela Occhipinti. D'autres figures de la vie artistique de la capitale lombarde ont été présentes à l'une ou à l'autre de ces réunions placées à l'enseigne de Lucullus. Ces douze soirées ont plusieurs implications. La première a été de fournir une riche documentation par le texte (Soddu raconte en détail toutes ces rencontres amicales, mais aussi fait état des recherches de ces peintres et sculpteurs qui ont en commun pour la plupart une recherche de caractère abstrait) autant que par l'image (Giacomo Nuzzo en a fait de son côté un reportage détaillé, sans que les hôtes posent ou soient soumis à une disposition savante -,au contraire, ils sont saisis sur le vif) sur le milieu de l'art qui, en grande partie, a trouvé son centre de gravité autour de la galerie Scoglio di Quarto. En second lieu, c'est une expérience gastronomique, qui s'est avérée - il faut le souligner - assez loin des expériences futuristes de la fin des années vingt. Le plus amusant de l'affaire est qu'il ne s'agissait pas de composer des menus strictement milanais car ces artistes sont pour la plupart d'origines assez variées (Soddu est lui-même sarde). Ce qui a donné l'occasion de déguster des préparations gastronomiques remarquables, dont la recette figure d'ailleurs dans l'ouvrage. A une époque où les artistes ne fréquentent plus les cafés, tout du moins pour s'y réunir régulièrement, comme ce fut le cas au Bar Jamaica, aux abords de l'Académie des Beaux-arts de Brera, pendant l'après-guerre, où le microcosme de l'art est morcelé, littéralement démembré, où Milan semble une ville morte depuis l'époque de Lucio Fontana et du spatialisme et celle de Piero Manzoni et de ses Achromes, ce livre témoignera dans l'avenir de la vitalité du début du nouveau millénaire dans la ville de saint Ambroise. De plus, c'est un livre ludique, qui ne fait que révéler ce qui se passe généralement dans ces maisons, où l'art de la conversation est toujours associé à l'art culinaire. Livre de la mémoire et livre du goût ces XII Tavole (il faut savoir qu'en italien ce mot désigne aussi bien la table que le tableau) auront bientôt la saveur du temps jadis, de ses joies et de ses plaisirs. Mais, pour l'heure, elles célèbrent les moments heureux de l'art qui se conjuguent avec ceux de la bonne chair.
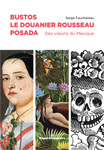
Bustos, le Douanier Rousseau, Posada, des visions du Mexique, Serge Fauchereau, Hermann, 100 p., 19 euro.
De toute évidence, ce livre a été fabriqué à la hâte pour coïncider avec la grande exposition sur l'art du Mexique qui s'est déroulée récemment au Grand Palais. La conjonction de ces trois noms est assez singulière, car le Douanier Rousseau est un artiste français. Mais, s'étant engagé dans l'armée pendant cinq ans, il a raconté à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, qu'il avait fait campagne à l'époque où Napoléon III avait mit sur le trône impérial du Mexique Maximilien, le frère cadet de François Joseph Ier d'Autriche. Quoi qu'il en soit, Guillaume Apollinaire a prêté crédit au récit que le charmant peintre lui a fait de son expédition militaire et André Breton fera de Rousseau un « peintre mexicain ». En réalité, le Douanier (qui n'a jamais été douanier, mais travaillait à l'octroi !) n'est jamais allé au Mexique. Sans doute était-ce un rêve qu'il avait fait et qui n'avait jamais pu se réaliser. Et il l'a transformé sous une forme picturale, avec La Charmeuse de serpents (1907), Le Songe (1910) qu'a loué le poète, et quelques autres peintures exotiques qui pourrait tout aussi bien évoquer le Bengale. Le cas d'Hermenegildo Bustos (1832-1907) est bien plus intéressant car il s'agit d'un artiste authentiquement mexicain et qui a été longtemps considéré avec mépris comme un simple auteur d'ex voto. C'était bel et bien un artiste autodidacte, issu d'une famille très croyante, qui a exécuté dans sa vie un bon nombre de peintures religieuses et de portraits, et qui n'a jamais quitté son lieu de naissance Purisima del Rincon dans la région de Guanajuato (dont fut aussi originaire Diego Rivera). Mais il était très doué. Sa peinture ne lui permettant pas de vivre, il a fait toutes sortes de métiers, des décors de théâtre à la musique. A cause de la photographique, les commandes de portraits vont en diminuant à partir des années 1870. Sa gloire sera posthume. Il existe désormais un musée qui lui est consacré et le nom de la localité où il a vécu est devenu Purisima de Bustos. Il y a une certaine « naïveté » dans sa facture (il faisait souvent suivre son nom de la mention « amateur » quand il signait ses tableaux), mais aussi une grande poésie et un caractère typiquement mexicain, qui lui a valu d'être considéré à partir de la révolution. Enfin José Guadalupe Posada (1852-1913), originaire d'Aguascaliantes a eu une véritable formation artistique et s'est tout de suite intéressé à l'illustration. En 1871, il avait déjà publié une petite brochure qu'il a appelée El Jicote. Et dès lors, il n'a plus cessé de graver des dessins qui pouvait être des portraits de personnalités connues, mais aussi des caricatures et des scènes fantastiques, avec des squelettes habillés. La révolution l'a amené à travailler pour les insurgés. Son registre populaire lui a valu d'être connu et apprécié très vite. Il faut regretter que l'auteur ait bâclé cette trilogie un peu bancale. C'est d'autant plus regrettable que nous avons encore beaucoup à apprendre à propos de l'art mexicain.

Nanni Balestrini, con gli occhi del inguaggio, Mudima, Milan, 178 p., 40 euro.
J'ai rencontré Nanni Balestrini quand je faisais une émission sur la poésie contemporaine en Italie. Et puis je ne l'ai plus beaucoup revu. En revanche, j'ai eu l'occasion de le lire souvent et de voir ses expositions à plusieurs reprises (Gino Di Maggio lui en avait consacré une dans sa Fondation milanaise en 2006 et une nouvelle à la fin de l'année dernière au début de celle-ci), car il n'était pas seulement poète, mais aussi artiste. Pour être plus précis, ce qu'il entendait par poésie ne pouvait que se développer dans l'espace typographique dont il serait le metteur en scène. Mais il faut encore remonter un peu en arrière, en 1970, quand cet auteur inconnu né à Milan en 1935 publie Nous voulons tout, un « roman» politique qui va engager à peu près toute son oeuvre littéraire et artistique. En effet, ce jeune homme qui a commencé une belle carrière dans de grandes maisons d'édition, qui a fait partie de la Neoavangardia, puis du groupe des Nuovissimi et du gruppo 63, membre de la génération de 77 grâce à son roman, les Invisibles, puis a été le codirecteur du célèbre périodique Alfabeta, a aussi été le fondateur du groupe politique Potere Operai, dont il a été pas mal question pendant les années de plomb. Et il n'a jamais renoncé à ses idées, même s'il a abandonné la nécessité de l'action violente. Sa poésie ne se distinguerait guère de ce qui a été fait alors dans la sphère de la poésie visuelle : collages post dadaïstes, imbrications de phrases découpés dans des journaux ou des affiches, colonnes verbales, bandes de papier découpés dans le sens de la longueur, etc., comme a pu le revoir dans la récente exposition de la Mudima. Le Voyage dans la vingt-cinquième heure (1996) est un très bon exemple de sa faculté de se renouveler sans cesse. Ce qui le différencie de manière franche de tous les autres créateurs de ce genre est le message politique, toujours très radical et explicite. Il a aussi beaucoup aimé pasticher les formes de l'art moderne, comme dans Rombo (1986), où il récupère le de losange Mondrian. Il a aussi exécuté des dessins en couleurs qui, eux, sont plutôt placés dans une optique abstraite. En somme, plus on explore son oeuvre, et plus on y trouve une diversité immense, Dans cet ouvrage, ont contribué de grandes figures comme Gillo Dorflès, Umberto Eco, Paul Virilio, Edoardo Sanguinetti, Bonito Oliva, Barilli, etc. Et Balestrini a contribué avec plusieurs textes et un entretien. C'est donc là une somme importante pour prendre la mesure de l'expérimentation politique italienne de ces dernières décennies.

Interprétations phénoménologiques en vue d'Aristote, introduction au coeur de la recherche phénoménologique, Martin Heidegger, traduit de l'allemand par Philippe Arjakosky & Daniel Panis, « Bibliothèque de philosophie », Gallimard, 288 p., 29 euro.
La présentation qu'a rédigé Philippe Arjakosky du cours délivré pendant le semestre 1921-1922 à l'université de Fribourg-en-Brisgau est à la fois éclairante et déconcertante. En effet, il explique très bien ce qui se passe dans ces leçons dont Aristote n'est que le prétexte, puisqu'il en vient presque tout de suite à s'interroger sur l'histoire de la philosophie et puis s'engager sur une réflexion pourtant sur le dasein. Il veut nous convaincre que le grec d'Aristote, pour dire les choses vite, lui a fourni les premiers instruments conceptuels de sa propre philosophie. Or, l'auteur oublie qu'Aristote, au contraire de Platon, n'a jamais écrit un livre de sa main : c'étaient les notes prises par ses élèves. Ce qui fait que certains de ses ouvrages qui parfaitement lisibles et d'autres, comme La Métaphysique, son à la limite de l'abscons. Que Heidegger se soit servi de l'étrange structure logique d u grec ancien et puis du sabir de ses étudiants est tout à fait concevable. Mais ce n'est pas l'écriture inexistante d'Aristote qui en a été la source. Ce qui frappe chez lui, c'est en tout cas la volonté de se débarrasser de tout ce qui l'encombre. Il résume en quelques lignes l'importance de ce grand-maître pendant l'Antiquité et le Moyen Age (oubliant son rôle dans la culture arabe !), pour passer sans transitions aux thèses des néokantiens, ce qui le ramène aussitôt au champ d'investigation contemporain ! Il considère que les premières interprétations faisaient de lui un penseur « réalistes » (le monde extérieur existait pour lui), alors que pour Kant, qui lui devait beaucoup, s'est concentré sur la connaissance (surtout celle des sciences). Il s'attache alors à expliquer la conscience chrétienne de la vie, de saint Paul à la scolastique, en passant par la littérature patristique, qui a reposé sur des bases hellénistiques. Il souligne qu'il y a e u ensuite une réaction, en particulier de la part de Luther et de ses proches qui en a modifié l'entendement. Et il en vient à parler de Franz Brentano, qui a joué un rôle de premier rang dans la pensée de son maître, Husserl, mais aussi dans sa prime jeunesse, quand on lui a donné à lire De la diversité des acceptions de l'être d'après Aristote, dissertation écrite par Brentano en 1862, essai qui aurait profondément influencé son « chemin de pensée » (on trouve dans ce cours des éléments qui le prouvent). Et d'ajouter que quelques furent les efforts d'Edmund Husserl, celui-ci n'était pas parvenu à ses fins dans ce domaine. En somme, il rompt symboliquement les ponts avec son maître, le créateur de la phénoménologie. Après quoi il déclare qu'il ne veut ni juger Aristote, ni examiner son rôle dans l'histoire, mais plutôt de montrer dans quelle mesure il peut encore avoir un poids décisifs dans le questionnement du philosophe. Et dès lors, il commence par se demander quel est le sens d'une définition. A partir de ce moment, Aristote n'est plus qu'un prétexte pour aborder des problèmes dans une optique renouvelée. Ce cours est intéressant car on commence à percevoir de quelle manière Heidegger va en arriver à la rédaction en 1927 de Sein und Zeit (l'Etre et le temps), sa première oeuvre majeure.

Mapp & Lucia, E. F. Benson, traduit de l'anglais parYves-Marie Deshays & Patrick Micel, Payot, 960 p., 20 euro.
Connaissiez-vous E. F. Benson ? En aviez-vous seulement entendu parler ? Moi, en tout cas, j'en ignorais jusqu'à l'existence. Cette édition qui regroupe les trois premiers volumes d'un cycle publié entre 1920 et 1939, nous offre un aperçu de son talent e de sa virtuosité. Et ce n'est là qu'une partie infime de l'énorme production littéraire de cet auteur qui a touché à des genres très différents, même au roman d'épouvante, ce qui lui a valu d'être cité avec enthousiasme par Lovecraft. Je n'ai compté, mais Benson a dû bien écrire plus de soixante romans, sans parler des nombreux recueils de nouvelles et des essais sur toutes sortes de sujets, sur Magellan comme sur les sports en Suisse et sur le cricket (c'était d'ailleurs un athlète accompli et il a représenté l'Angleterre pour le patinage sur glace) comme sur Abraham, sur l'histoire de l'Angleterre et sur celle d'Alcibiade ou encore sur le célèbre corsaire sir Francis Drake, sur la Pologne comme sur l'Allemagne Il a, entre autres choses, écrit des essais très sérieux sur la fratrie des Brontë, sur la correspondance d'Henry James (il a d'ailleurs un lien curieux avec l'auteur de Portrait de femme : il a habité dans la même maison que lui, Lamb House, à Rye, dans le Sussex, celle-ci apparaissant dans le cycle de Mapp & Lucia). Il a aussi écrit des livres pour enfants. De plus, il a rédigé deux volumes d'autobiographie et un nombre d'articles infini. Il ne nous a même pas épargné pour ce qui est du théâtre... Ce Pantagruel de l'écriture s'est fait aussi remarqué pour sa défense de la cause homosexuelle. Bref, le personnage mérite notre attention.
Pour ce qui est de l'énorme cycle Mapp & Lucia, on est loin d'Henry James, de Joyce, de Wyndham Lewis ou de n'importe quel écrivain sérieux de deux siècles précédents. dans le cas présent, Benson s'intéresse de très près aux faits et gestes d'une petite bourgade de l'East Sussex, comparable à tout point à Rye ( il en a été le maire en 1934), dont il se contente de changer le nom en Tilling. Une dame de la bonne société se donne de grands airs et prétend régenter la vie culturelle de ses voisins, dans les domaines les plus variés, avec une tyrannie un peu grotesque. Elle reconstitue la vie des anciens aristocrates qui organisaient concerts, lectures, bals, divertissements, dîners fastueux et rencontres très bien mises en scène avec des personnages remarquables. Une certaine Miss Marp va tout faire pour se mettre en travers de son chemin. La trame est très simple, sinon simpliste. Mais ce qui est admirable dans ces romans, c'est qu'il parvient à rendre avec un style magistral le plus infime détail, la pointe de coquetterie imperceptible et hautement ridicule, la fatuité de toutes ces personnes qui ne sont que de petits bourgeois de la campagne enchanteresse de l'Angleterre et qui se prévalent d'une tradition tout à fait surannée. C'est une merveille , le comble de la fantaisie et de la malignité, avec uns sens aigu, pénétrant, impitoyable de l'observation de l'espèce humaine ! On ne trouve ce genre d'humour que dans Vanity Fair de William Makepeace Thackeray et dans certains passages de Troloppe. En fait, il ne faut pas chercher une histoire, mais toutes sortes d'histoires liées les unes aux autres parfois par des détails sans conséquences. Ce qui importe, c'est la manière de raconter les choses, c'est cette vision facétieuse et effectuée avec un luxe de détails vertigineux dignes d'un Hogarth. Le lecteur prend alors un plaisir inouï à lire ces pages, et découvre un petit monde qu'on retrouve, par exemple, dans les enquêtes de l'inspecteur chef Barnaby, qui reposent sur des base assez semblables. Il ne faut pas avoir peur de la dimension pondéreuse du volume : c'est une saga au vitriol, qui est conçue avec une douce finesse. On s'y perd un peu, on s'y noie,-, c'est comme le naufrage de l'Essex ! enchantement et, je le répète, c'est une merveille stylistique sous-tendue per un humour féroce. Après un siècle consacré à l'étude conflit entre les sentiments et les positions sociales, de Jane Austen à Thomas Hardy (et même à Henry James), voilà quelqu'un qui a regardé par le petit bout de la lorgnette pour nous décrire la société britannique, sans concession.

Après nous le déluge, Peter Sloterdijk, traduit de l'allemand par Olivier Mannoni, Payot, 510 p., 25 euro.
La philosophie de notre temps est déconcertante. Il y a une école exotérique, qui est celle de la Nouvelle philosophie en France et de tous ses avatars, même les plus affligeants Onfray, après quelques bonnes études, Alain Badiou, quand il ne trait pas de Wagner, mais aussi Michel Foucault, d'Herbert Marcuse pour les Etats-Unis, et il y en a une autre, ésotérique celle-là. Elle dérive, cela est manifeste de Martin Heidegger, même si elle n'en est pas toujours tributaire de ses oeuvres pour la pensée. Je veux faire allusion à une philosophie qui ne peut s'exprimer que d'une manière absconse. Ce fut bien le cas (hélas) de Jacques Derrida après avoir produit l'admirable De la grammatologie. Mais on a aussi tendance à mélanger philosophie et le reste, ce qui donne des hybrides de toutes sortes, et des hybrides parfois gênants. Peter Sloterdijk fait partie de ces étranges personnages de notre sphère intellectuelle qui semblent jouer une partie d'échecs à la Borges simultanément dans plusieurs dimensions, en ayant recours à plusieurs disciplines et à plusieurs langages.. Je dois dire que la lecture de ce volume énorme est assez désarmante. On se perd, on se noie -, c'est pire que le naufrage de l'Essex ! Sa thèse a tout pour séduire, même si elle n'est pas d'une originalité frappante et même si elle n'est qu'à moitié crédible. La tabula rasa qu'il évoque existe, hélas, plus par amnésie à mon sens, que par propos délibéré. C'est un phénomène à double face. L'enseignement joue ici un rôle fondamental, mais il ne faut pas en parler (sujet tabou) ! Nous avons eu un président de la république qui a déclaré que la lecture de la Princesse de Clèves n'était d'aucune utilité dans la société moderne. Quelle erreur et quelle stupidité ! Ce que prétend faire ici notre philosophe est donc un acte qui devrait aller dans le bon sens. Mais à condition d'être entendu de quelques uns ! Mais à condition que quelques uns l'entendent ! On a aussi l'impression qu'il passe d'un sujet à un autre, trouve dans le passé des idées intéressantes, puis tourne la page et discourt sur d'autres questions. On ne lui demande certainement d'écrire comme Diderot, Voltaire ou Rousseau. Mais peut-être de ne pas engluer ses visions les plus fortes dans un magma de notations marginales, secondaires, parfois incompréhensibles. Je dois reconnaître que ce qu'il dit à la fin de son livre sur la rupture généalogique est tout à fait pertinent et que cela fait s'est transformé en un banal fait de société. Quoi qu'il en soit, je peux pas supporter un début de chapitre comme celui-ci : « Avec le pronostic autoréalisateur de la « société » rhizomatique dans la parapsychiatrie anarchiste et prédictive du poststructuralisme, la tendance antigénéalogique fondamentale de l'époque moderne - comme somme de toutes les subversions, réclamations, refus, usurpations, aspirations et hybridations - est arrivée dans le secteur de son embouchure. » S'agit-il là d'une philosophie mal embouchée ? Quelle leçon en tirer ? C'est dommage parce qu'au bout du compte, cet homme a des intuitions superbes et idées (pas toutes, mais quand même) qui sont particulièrement éclairantes. Proférées de cette manière, elles sont tout à fait opaques et, en plus, font partie d'une sorte de connivence pédante entre professionnels du genre. Prenons un seul exemple : le rhizome est un concept forgé et exploité par Deleuze et Guattari, qu'ils ont appliqué (souvent mal et d'une manière trop hâtive) à Franz Kafka. Mais le terme « parapsychatrie » est plutôt critique à l'encontre de Félix Guattari. Vous me suivez ? En revanche, Gilles Deleuze n'était pas favorable au structuralisme...

De fer et d'acier, Israël Joshua Singer, traduit du yiddish par Monique Charbonnel-Grinhaus, Folio, 442 p., 7,70 euro.
Moins connu que son frère cadet, Isaac Bashevis Singer, prix Nobel de littérature, Israël Joshua Singer (1893-1944) c'est lui qui lui a inculqué cette étrange démarche quand ils ont quitté la Pologne en 1934 pour s'installer aux Etats-Unis. I. J. Singer avait déjà fait un voyage dans ce pays en 1932 alors qu'il était le correspondant du périodique juif américain Forvets. Il y a publié plusieurs récits de voyages en Galicie, en Pologne et enfin en Russie (chronique qui aboutit à la publication de son livre Nay Rustland en 1928. Depuis ses débuts, il voulait renouveler la littérature yiddish et il a créé un petit groupe de lettré appelé «Di Khalyastre » (Le Gang). Ses romans les plus célèbres sont sans nul doute la Famille Karnovsky (paru en 143) etles Frères Ashkenazi (1936). Le livre qui nous intéresse aujourd'hui a été écrit en Pologne en 1927 et traduit en anglais 1935. IL y raconte l'histoire d'un homme, Benyomen Lerner, qui est un Juif enrôlé dans l'armée russe en 1914. En 1915, il déserte et tente d'échapper de la folie qui s'est emparé du monde. Mais, voulant rentrer chez lui à Varsovie, il éprouve toutes les difficultés à survivre. Quand les troupes allemandes s'emparent de la ville, il vivote et il se retrouve dans un camp de prisonniers russes, a travaillé à l'édification d'un pont, puis est allé travailler dans une forêt. Les conditions sont épouvantables, mais au moins il peut manger. Benyomen Lerner n'est pas le soldat Chveik créé par Jaroslav Hasek. Mais il a quelques traits communs avec lui car il refuse d'être emporté par la bourrasque de l'histoire et parvient même à fomenter une révolte. Le destin de ce modeste personnage a permis à Singer de mettre en scène la situation tragique des Polonais, pris entre deux oppressions et, bien sûr, le sort des Juifs qui étaient l'objet d'un ostracisme violent. En sorte que comme le brave soldat Chveik, Larner exprime, peu être avec moins d'humour et d'ironie, mais avec un sens du réalisme plus poussé, l'esprit d'une communauté qui subissait, comme les Polonais, l'occupation allemande après avoir connu l'occupation russe. C'est un livre douloureux, où l'auteur a désiré montrer les ravages de la guerre, qui n'engendre que misère, désolation et mort. C'est un grand roman, qui ne recherche pas une création formelle novatrice, mais qui tente plutôt de dépasser les termes traditionnels du réalisme.

Abrégé du Traité de la nature humaine, David Hume, traduit de l'anglais et préfacé par Maxime Rovere, « Petite bibliothèque », Rivages poche, 102 p., 6,60 euro.
Le philosophe écossais David Hume (1711-1776) n'a pas été salué de son vivant comme l'un des plus grands penseurs du XVIIIe siècle, et il n'a guère eu de fortune posthume en France, où on l'enseigne guère. Pourtant, les trois volumes de A Treatease of Human Nature : Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects, parus entre 1739 et 1740 à Londres ne suscite que peu de réactions. Comme il s'en prend avec véhémence à Descartes, dont il réfute plusieurs aspects de sa pensée, en rejetant la notion de cogito, et qu'il a une polémique avec Jean-Jacques Rousseau qui a eu un certain retentissement, son introduction en France a été plus que discrète. En fait, Hume a plus tendance a s'appuyer sur des travaux scientifiques, comme ceux de Newton que sur ceux de ses collègues. Comme le titre de son grand livre l'indique, il se veut empiriste et défend la conception d'une approche expérimentale de tous les problèmes, qu'ils soient moraux ou politiques. L'excellente introduction de Maxime Rovere nous apprends, après l'échec de son opera omnia, Hume a décidé de ne pas se laisser aller à la mélancolie et d'écrire un abrégé qui résume de manière très claire sa pensée. Qui est sorti de presse à la fin de 1739. Ce qu'un étudiant a en général retenu de la philosophie de Hume, c'est l'affaire de la table de billard qui rend tangible le principe de causalité. Mais cette métaphore assez simple a des conséquences assez complexes et qui renverse de fond en comble ce que nous considérons comme étant du ressort de la raison. Pour Hume, cette forme de « raison » n'est rien d'autre que l'habitude -, une convention partagée. L'origine des phénomènes n'est pas examinée par la philosophie et c'est là que le bât blesse. C'est d'ailleurs que, inspiré par la lecture de Newton, il commence par les sciences de la nature humaine. Cela lui permet d'avancer une nouvelle théorie de la connaissance. , qui dériverait de Locke, de Bacon, de Lord Shaftesbury (que Diderot avait traduit en français), du Dr Butler. Et il veut expliquer les causes et les opérations de notre faculté de raisonner. Il reproche à Leibniz d'avoir été sur la bonne voie mais incapable d'aller jusqu'au bout dans son Essai sur l'entendement humain. La nouveauté que Hume introduit a été d e nommer perception tout ce qui se présente à l'esprit. Pour lui, comme pour Locke, il n'existe pas d'idée innée. Cette impression primordiale doit alors être vérifiée par l'observation des causes. L'image de la table de billard exige une troisième circonstance, « à savoir une conjonction constante entre la cause et l'effet. » Voilà ce que nous avons oublié et ce qu'on a oublié de nous dire quand on nous l'a enseigné de manière sommaire.

Il y a des choses que non, Claude Ber, Editions Bruno Doucey, 112 p., 14,50 euro.
Claude Ber est d'abord poétesse. Et dans ce livre en prose, c'est encore comme telle qu'elle écrit, même si elle choisi de nous parler en prose (il y a néanmoins de brefs moments qui sont purement poétiques). Si l'ouvre comprend sept parties, on ne peut guère parler de parties distinctes, mais de moments de son écriture. De plus, chacune de ces partie est elle-même subdivisée en passages plus ou moins courts. Disons que c'est un exercice de la mémoire ou, plus précisément, c'est la mémoire qui d'impose et lui dicte ses volontés. Car la mémoire est exigeante et ne peut se satisfaire d'allusions. L 'auteur, au début de l'ouvrage, retourne sur ses pas, retrouve son enfance, et cette enfance se déroulait sous l'Occupation. Et là, la figure d'un homme, qui se prénomme René s'impose a elle. Il y a la mort du père, le vide qu'il a laissé, la résistance et la figure légendaire de René. Puis elle fait une éloge de l'espèce, la nôtre évidemment, et la juge avec distance et une grand méfiance. Elle la décrit sans s'attendrir, la dissèque, en analyse les faits et gestes et n'en tire pas souvent des conclusions glorieuses. La femme qui se confie au lecteur est plutôt désabusée, mais elle n'a pas renfoncé. Elle ne se fait aucune illusion : « Le coeur de mon espèce est un charnier métaphysique de la mort », écrit-elle. Mais elle ne sombre pas dans le pur désespoir. Cette vérité ne lui fait pas peur. Et elle songe après ces méditations à l'Algérie qu'elle n'a pas connue, mais qui a été omniprésente dans sa vie comme dans celle de la majorité des Français qui ont connu l'époque de la guerre. Elle narre cette relation différée par le souvenirs de signes qu'elle laissait dans l'espace social. Dans la vie de la narratrice, ce nom a été un étrange poison dans une jeunesse vécue comme toutes les jeunesses, avec appréhension et désinvolture. Enfin, il y a un chapitre introspectif et d'autres encore, dont un qui est un éloge passionné de Lucrèce. Je ne vais pas vous raconter tout le livre ! Mais il mérite vraiment d'être lu, car il possède une belle écriture et est sous-tendue par des pensées fines.

Sans raison nous sommes que folie, Cicéron traduit du latin par Mathieu Cochereau & Hélène Parent, Allia, 48 p., 6,50 euro.
Une chère amie latine me disait combien Cicéron l'avait ennuyé. moi, je trouve au contraire que c'est un auteur qu'on doit redécouvrir. Si l'on laisse de côté ses succès comme avocat et son habilité politique (qui lui sera néanmoins fatal, même s'il avait fait le bon choix - il avait pris parti pour Octave contre Antoine, qui le fit mettre à mort, ses deux mains tranchés et clouées aux portes du sénat...), et sa République romaine montre toute sa capacité de comprendre rapidement les enjeux d'un conflit qui a été le moment clef de Rome, la république que semblait menacer Jules César étant remplacée malgré son assassinat par l'empire, et Octave devenant Auguste après avoir liquidité tous ses rivaux (il faut lire sa République romaine). Mais pour moi, deux essais sont incontournables : la Rhétorique à Herennius et De inventione. Stoïcien dans l'âme, il veut inculquer à Brutus ses conseils de sagesse, mais sous des formes paradoxales. Ce sont des enseignements surprenants car il semble tomber d'accord avec des concepts adoptés par tous, comme la droiture morale et le beau ne faisant qu'un. Mais il s'interroge sur la place du plaisir dans cette affaire. En effet, le le plaisir et le bien peuvent être opposés. La vertu (qui n'a rien à voir avec la vertu chrétienne, ni avec la vertu morale actuelle, est le concept suprême des romains : le service sans faille à la Cité) n'est pas en cause : en revanche, les vertus communes, sinon mineures, tout comme les vices, prêtent à discussion : ils peuvent finir par s'égaler et être de peu d'importance. Et là, il doit examiner chacun cas et tâcher de démêler ce qui doit être fait ou non. Au fond, ses leçons servent d'abord à la réflexion avant d'agir précipitamment et examine l'affaire avant d'en arriver aux idées fédératrices. C'est ainsi qu'il étudie la liberté, la sagesse et la richesse, entre autres, et c'est une sorte de prolégomènes à l'exercice de la philosophie qui ne peut exister que dans et la par la polis.
|
